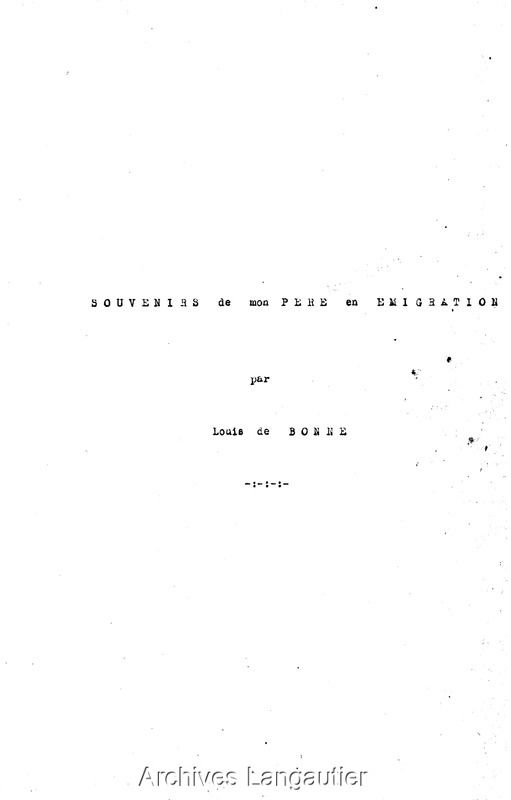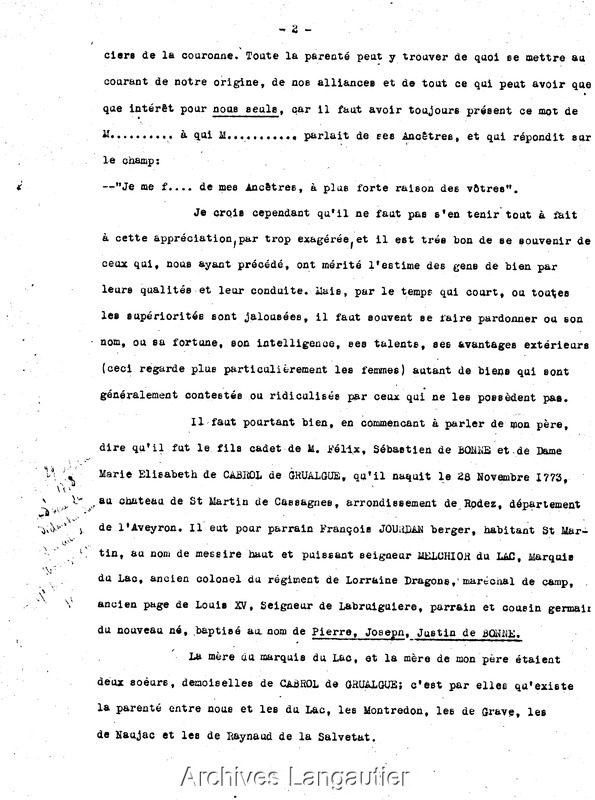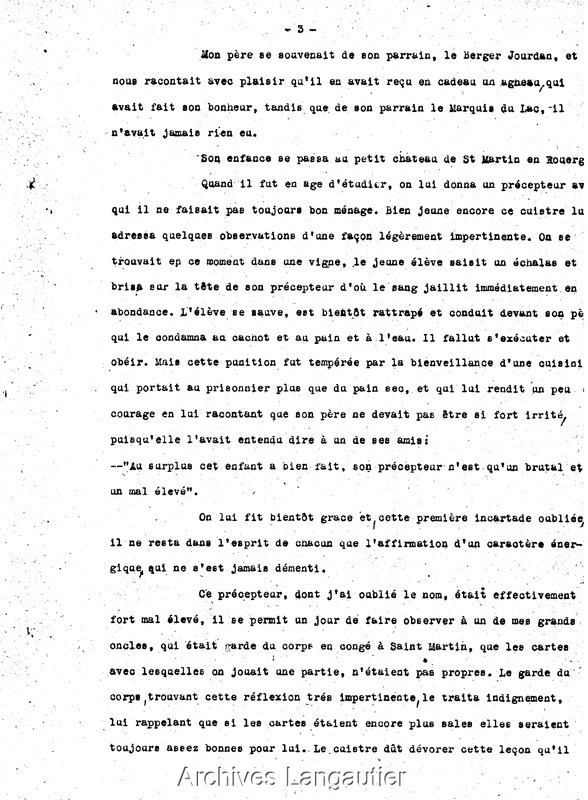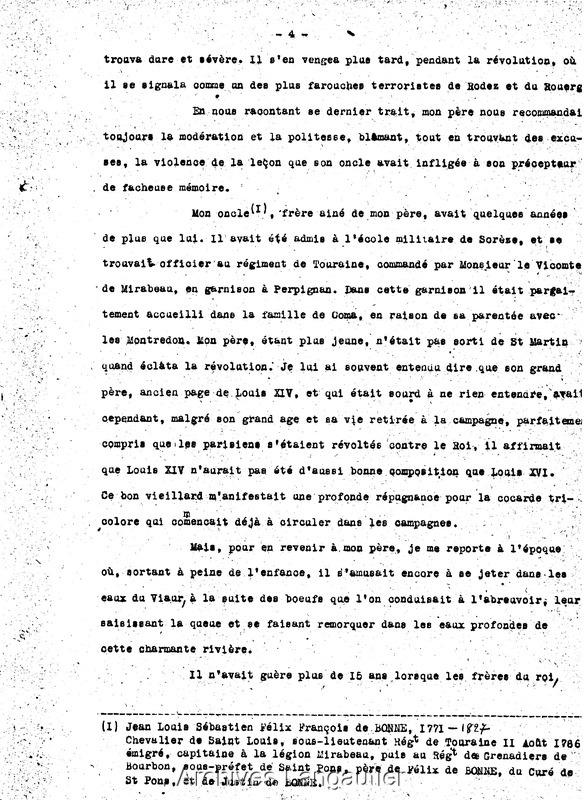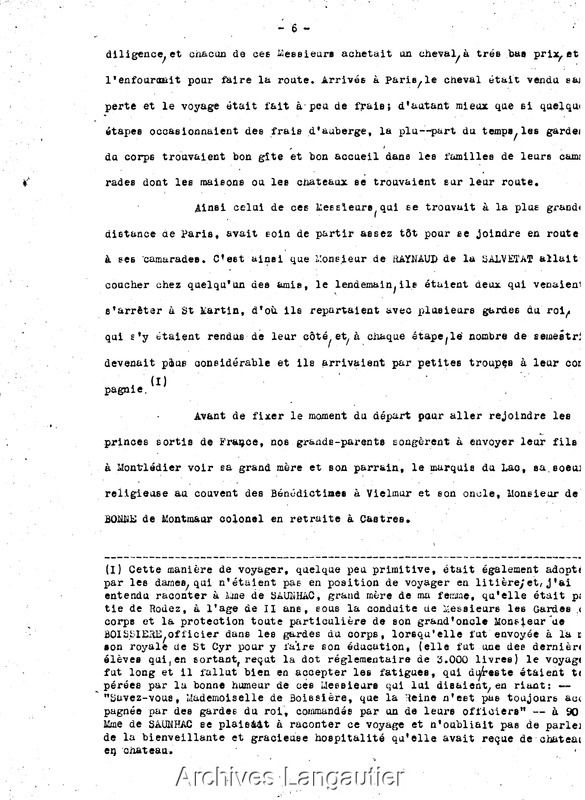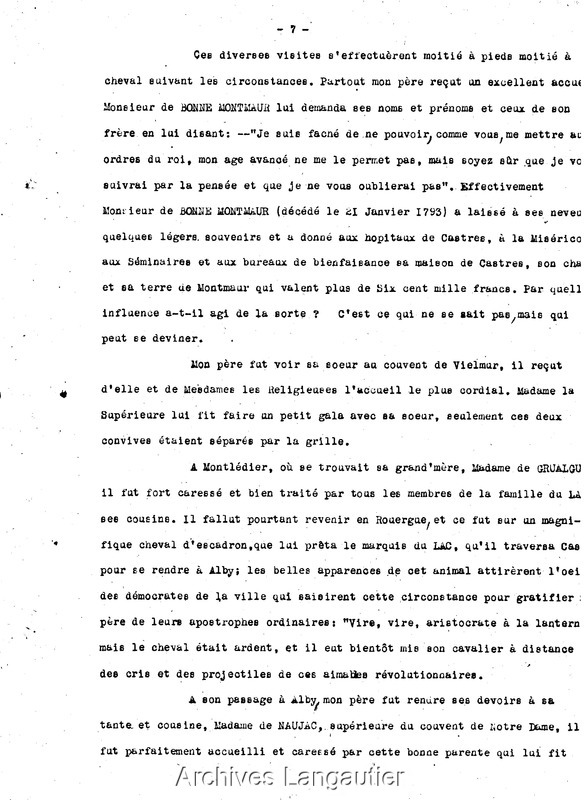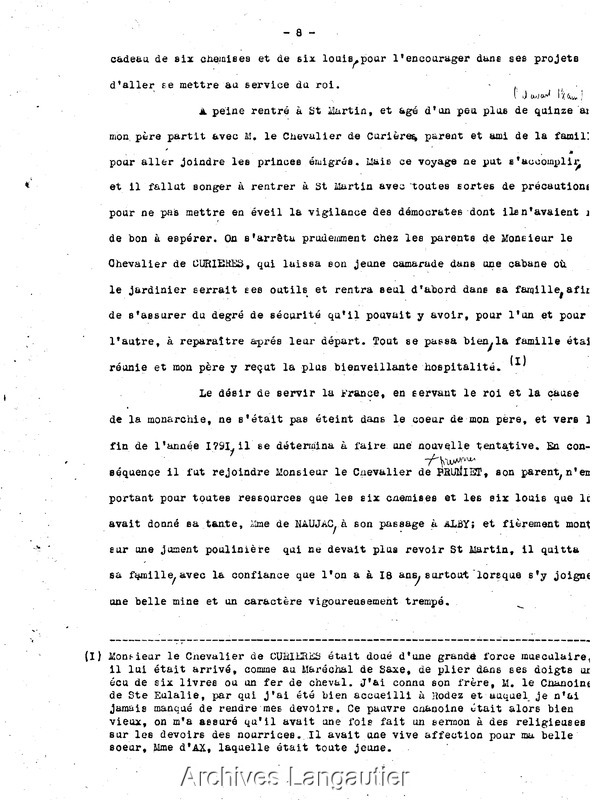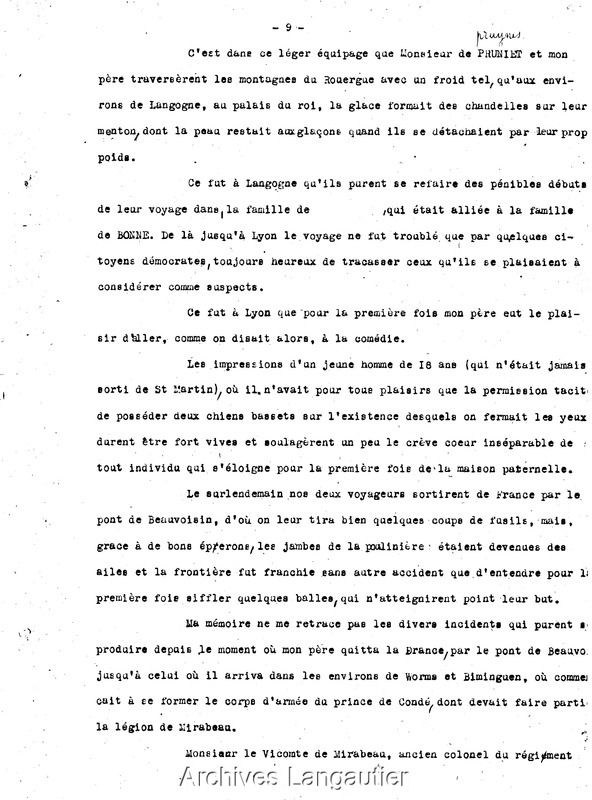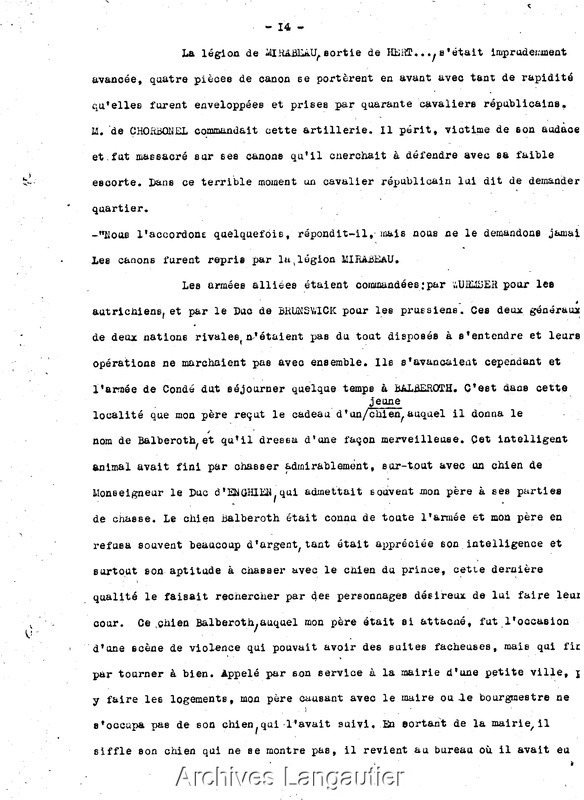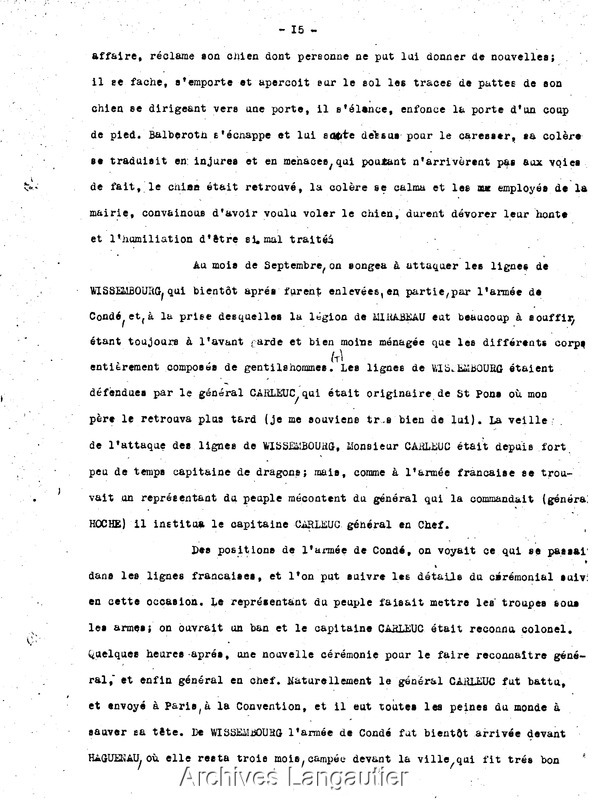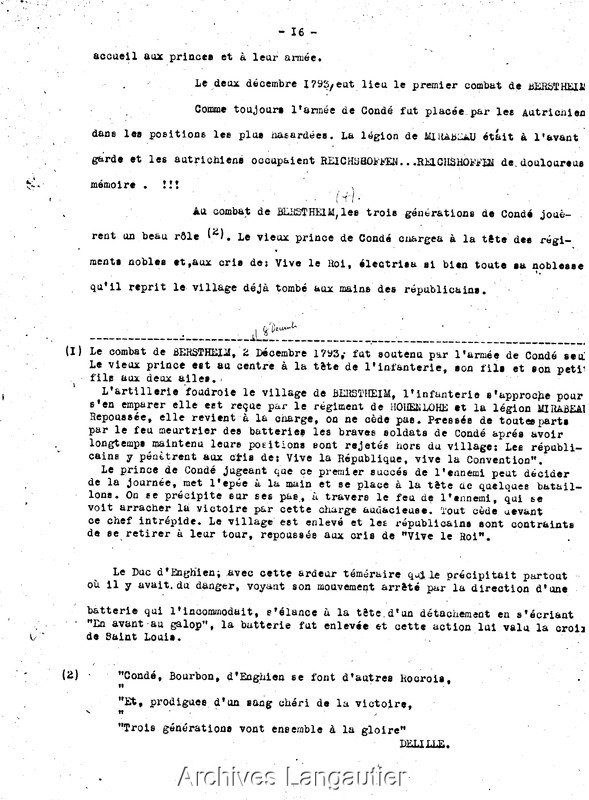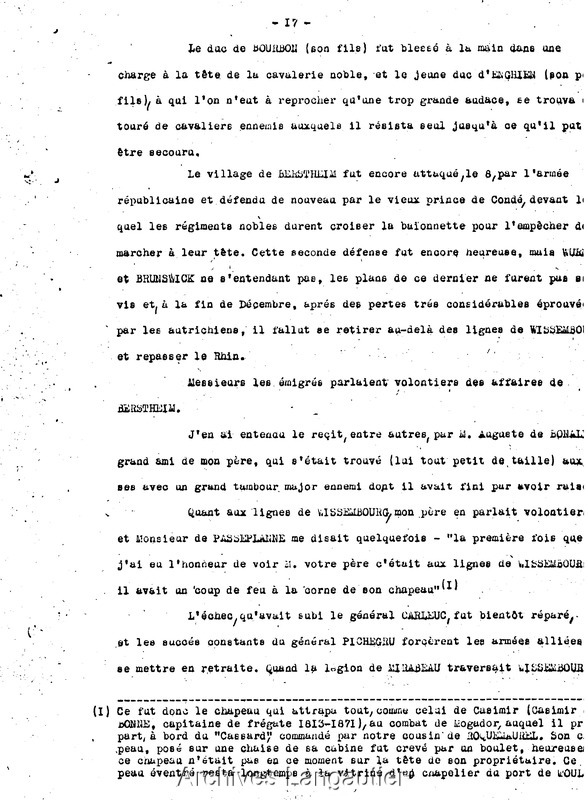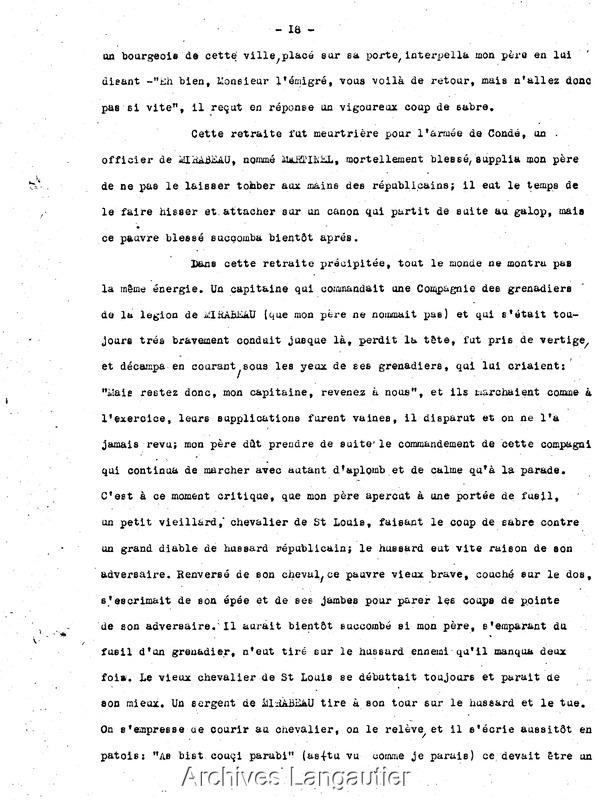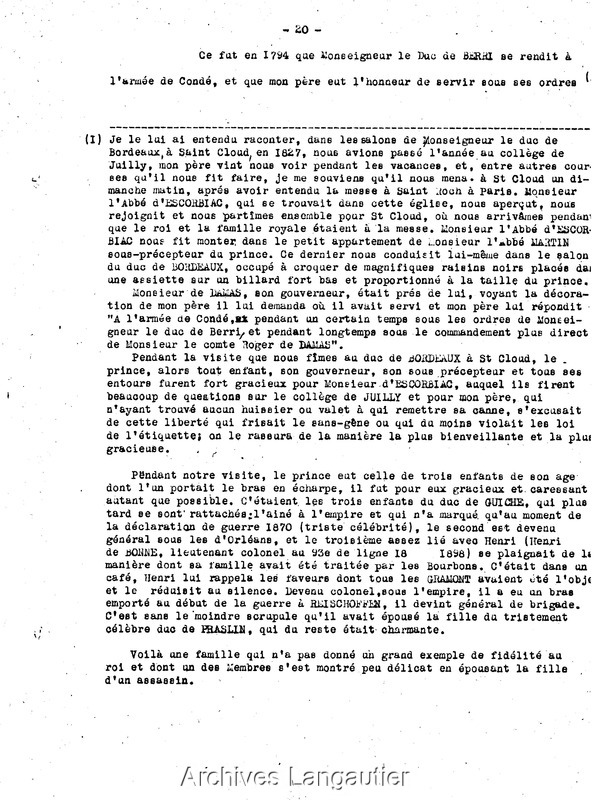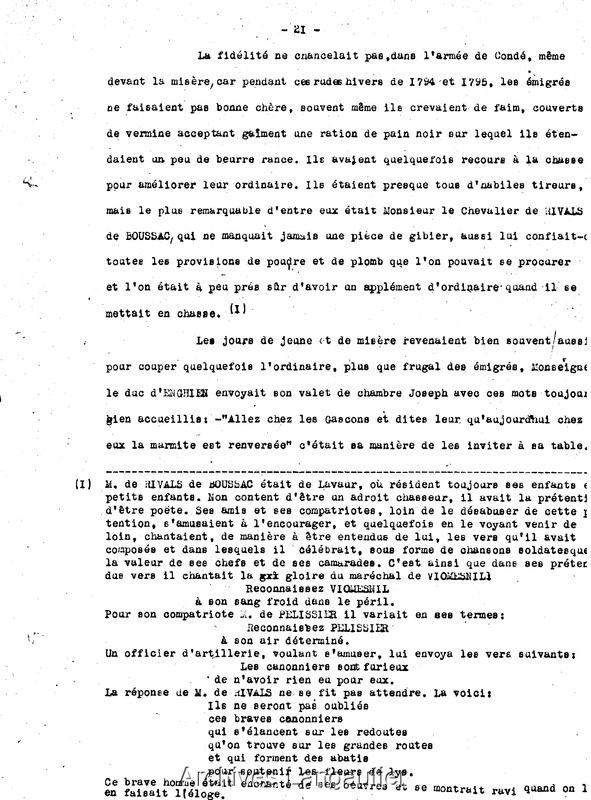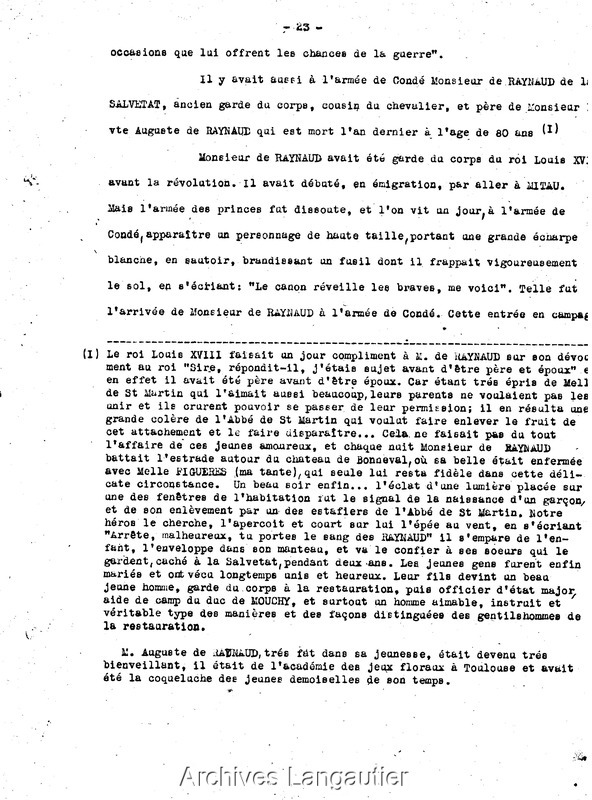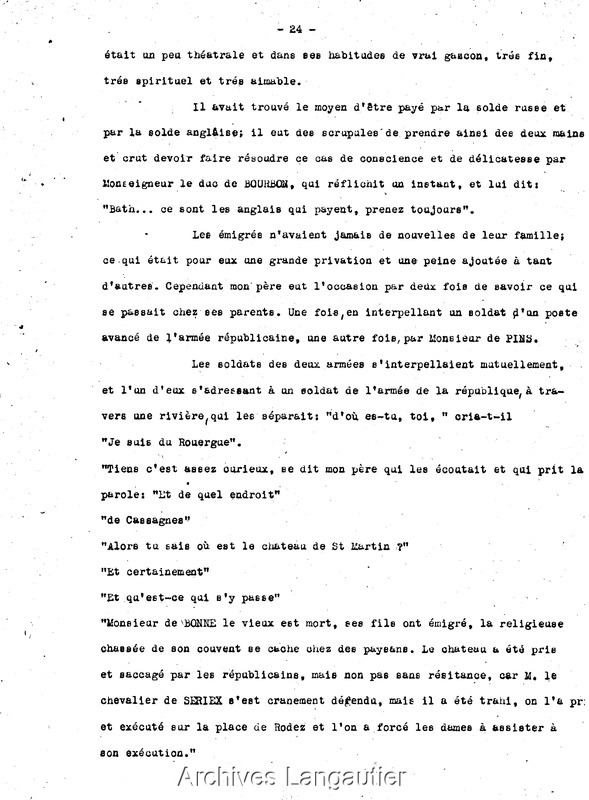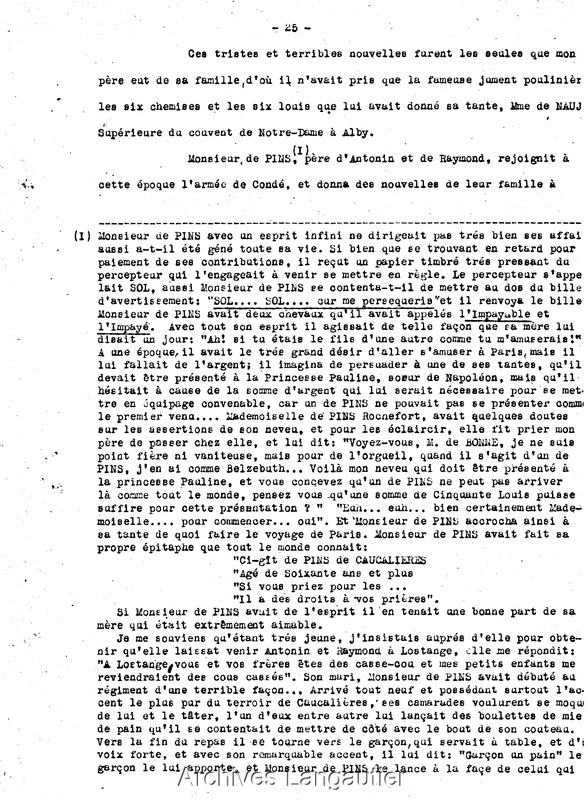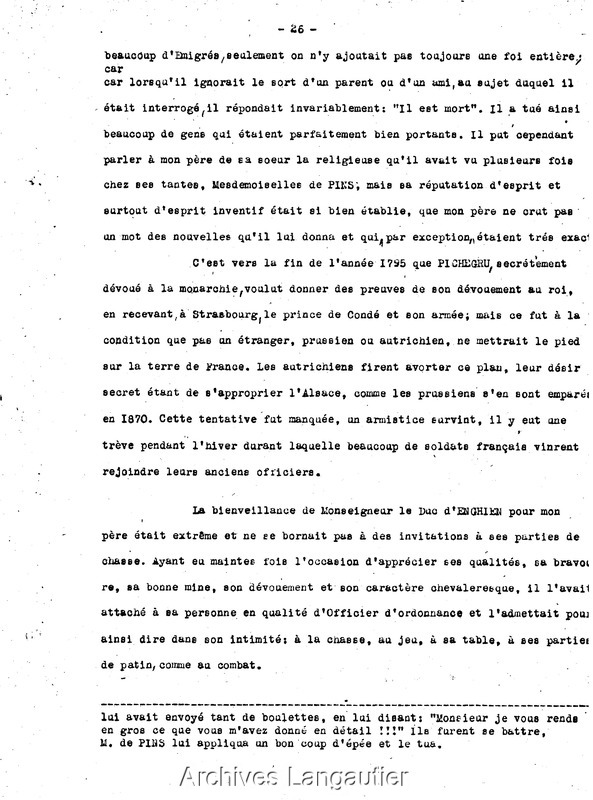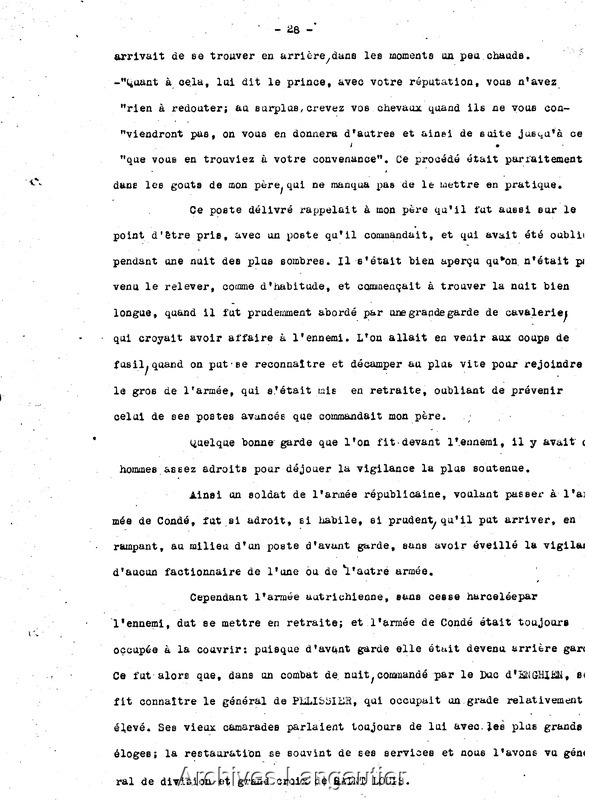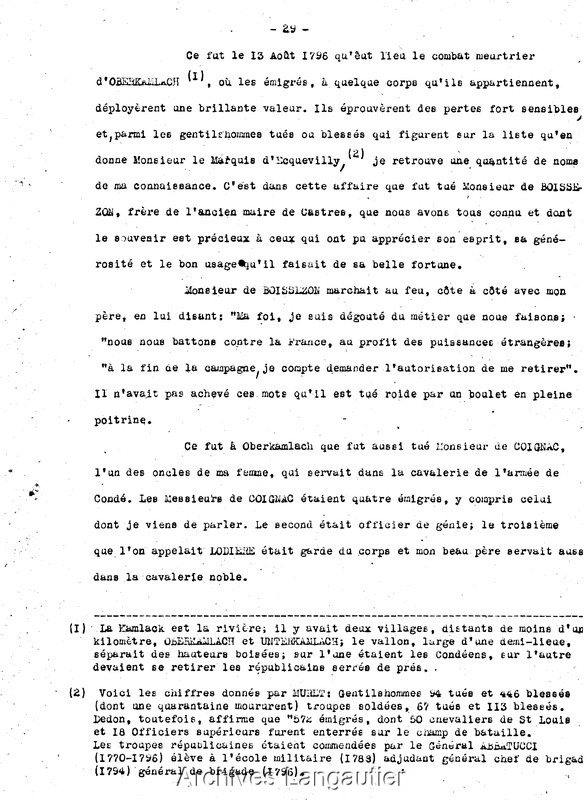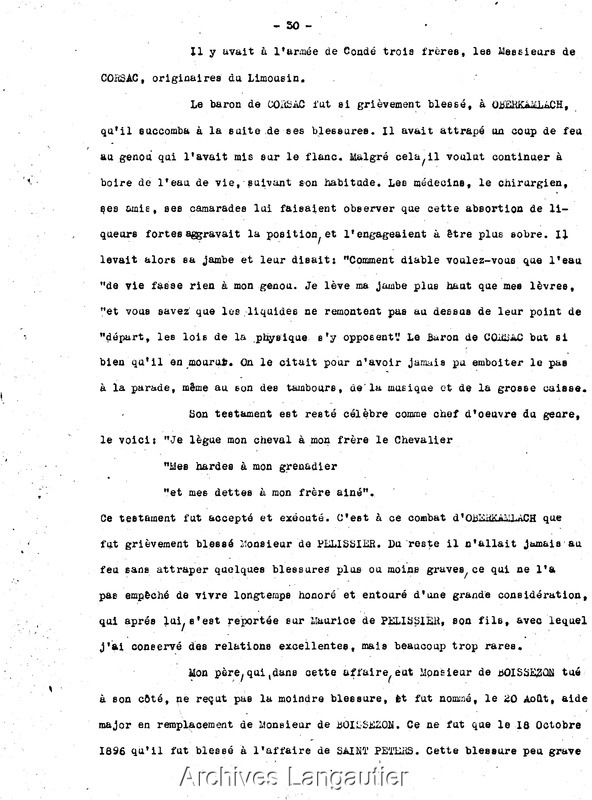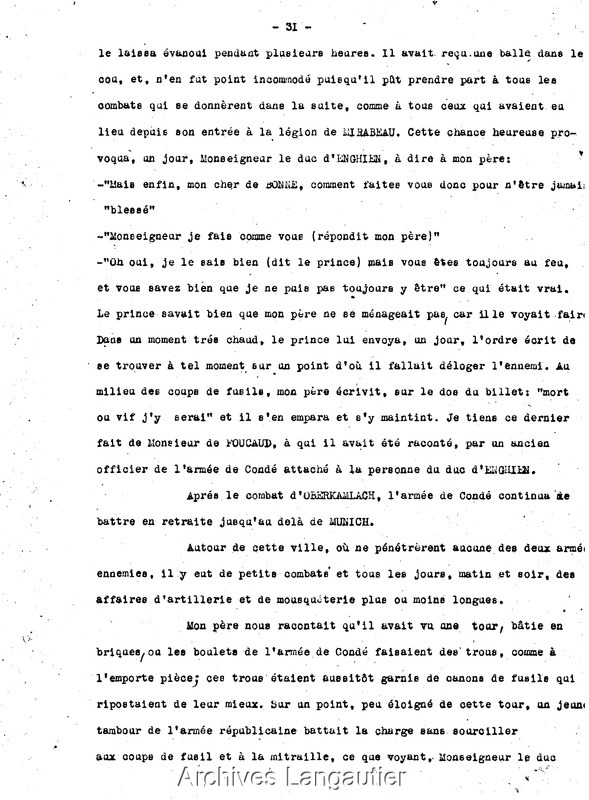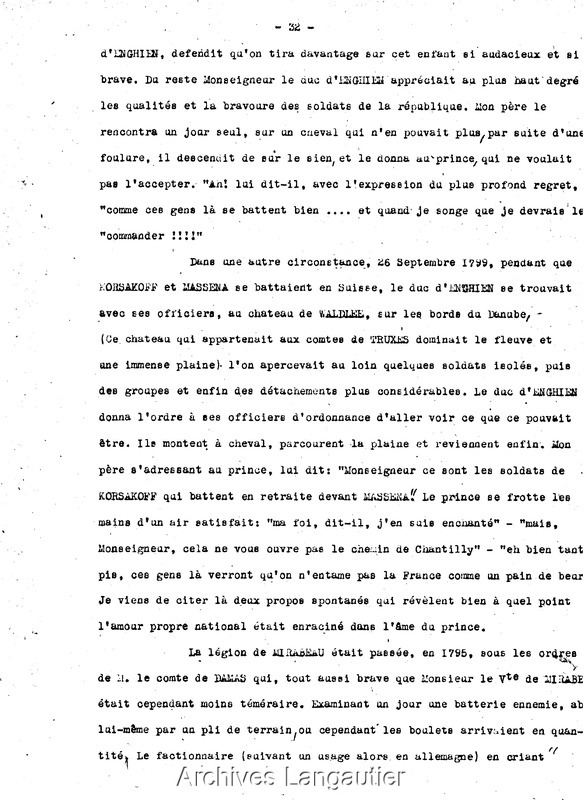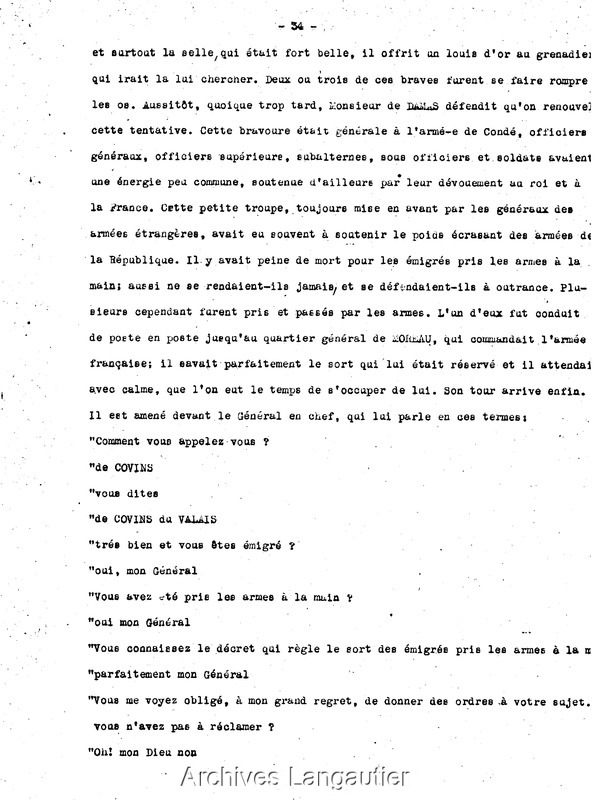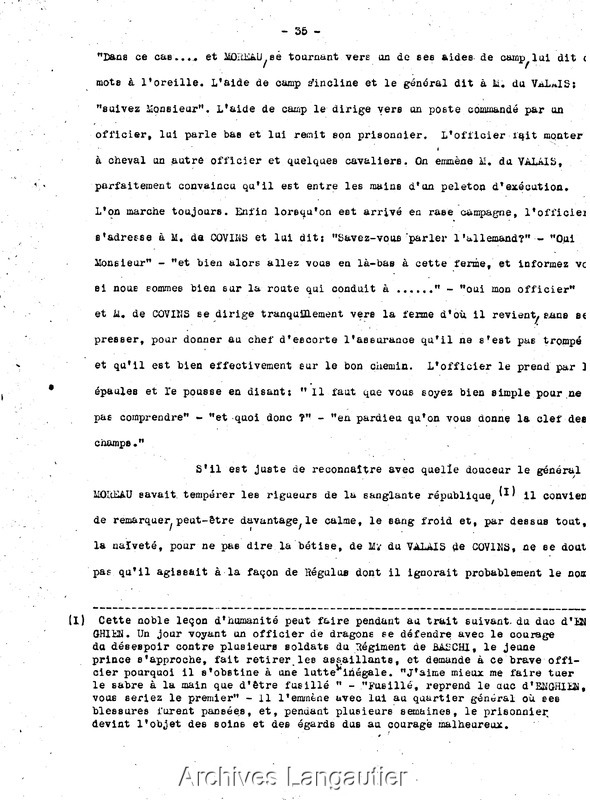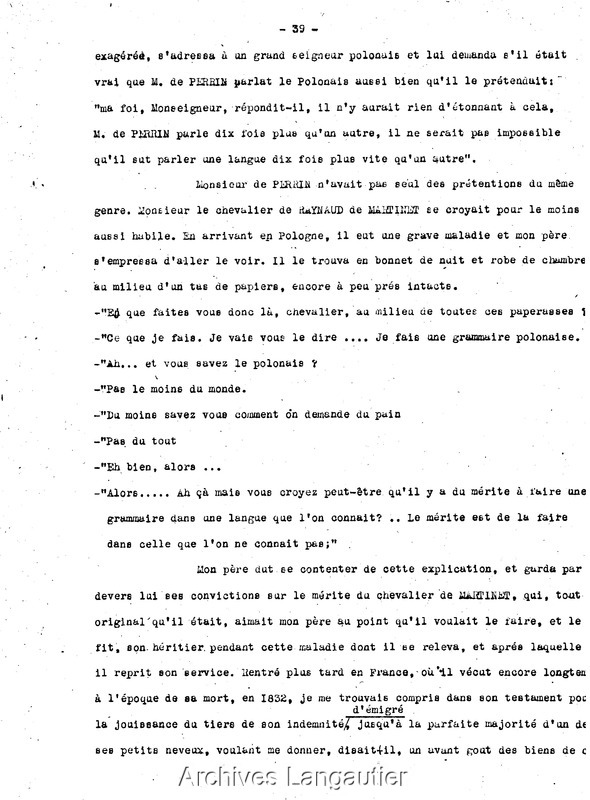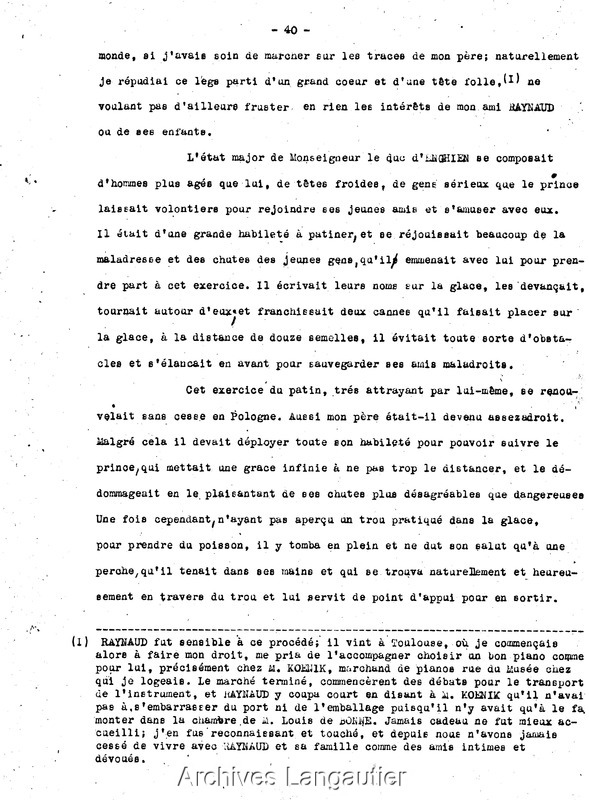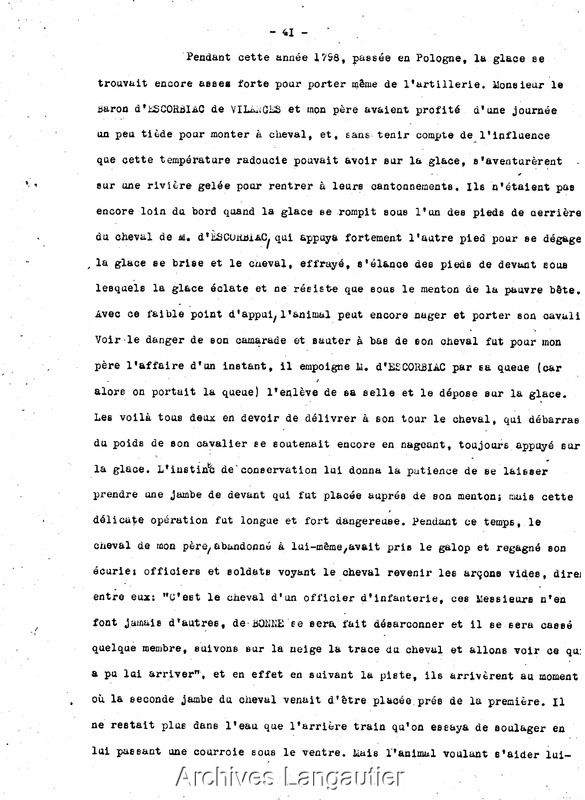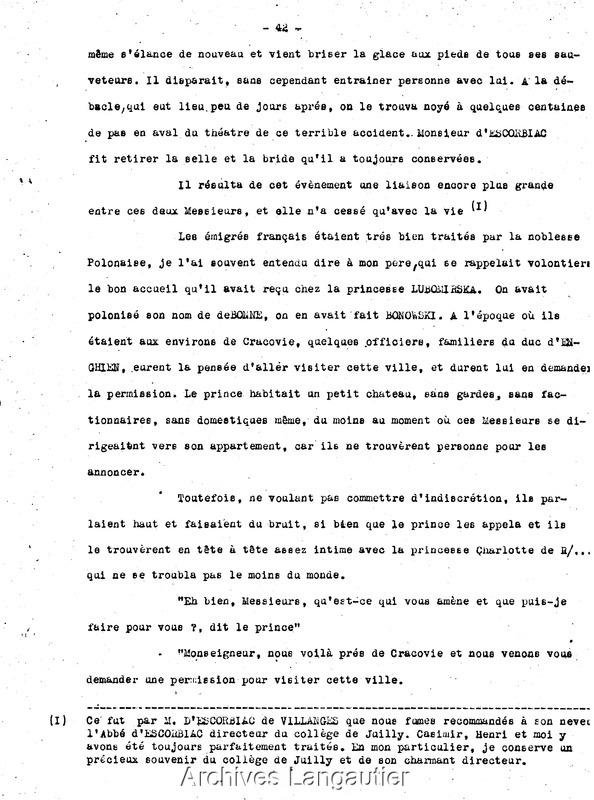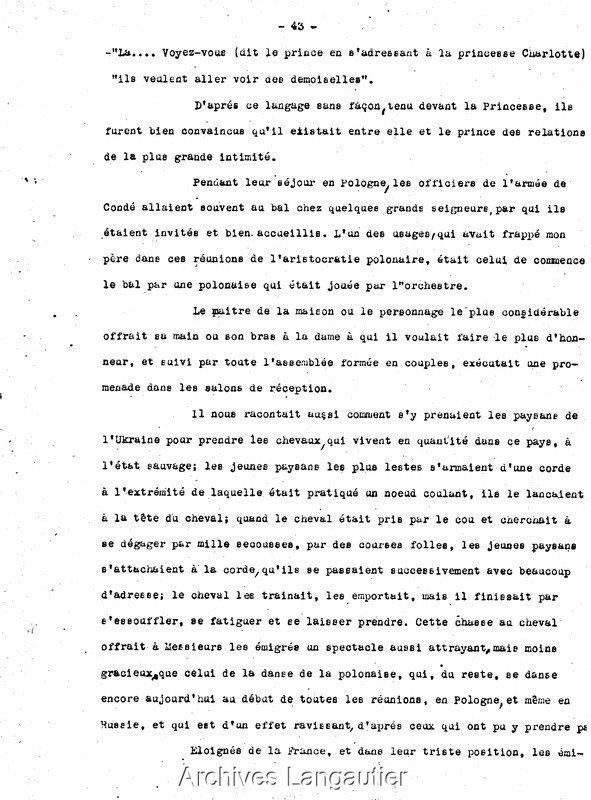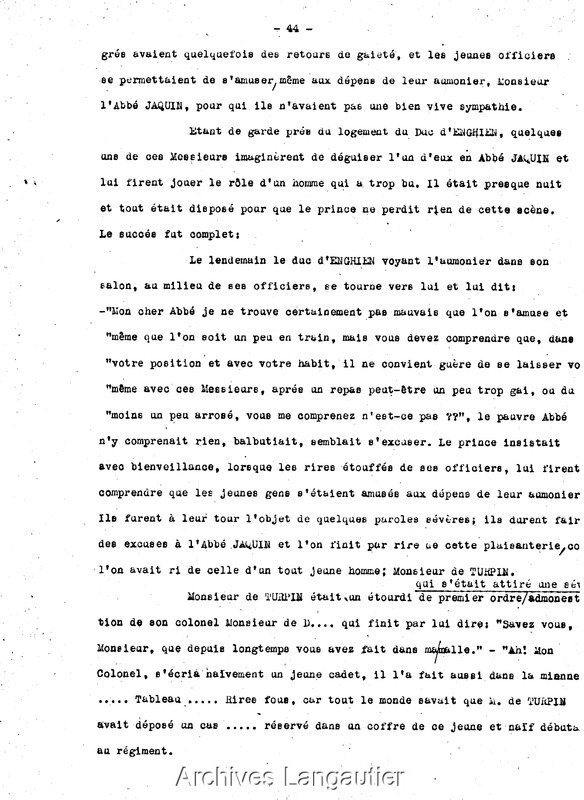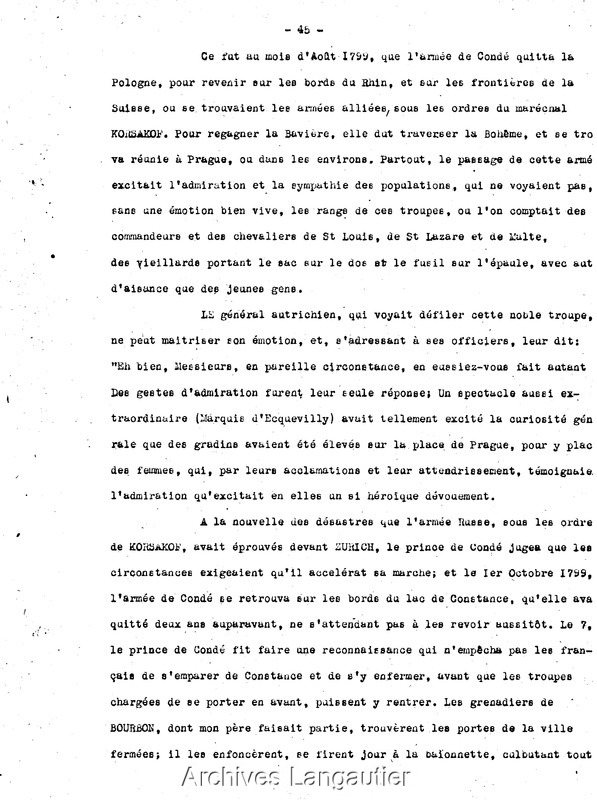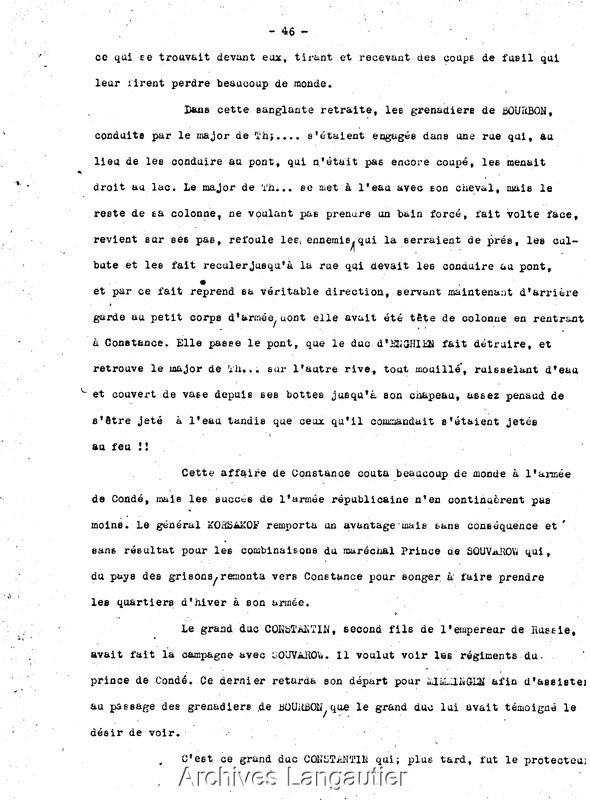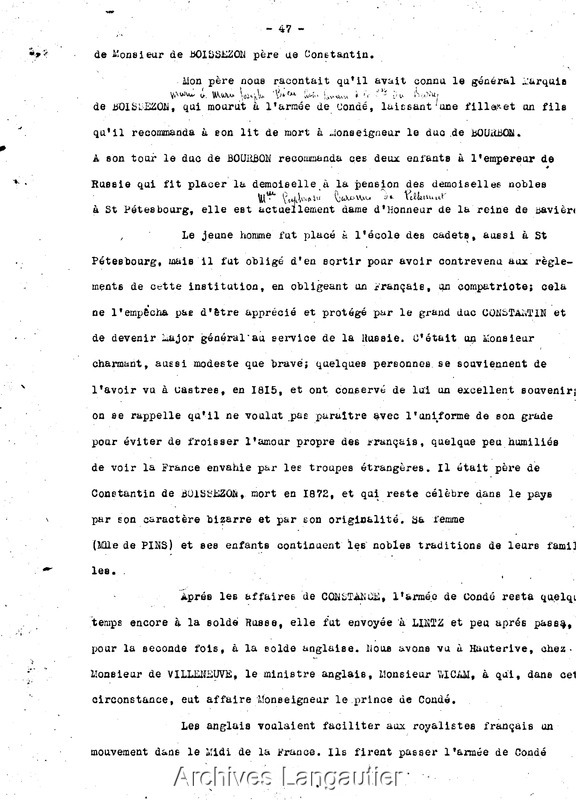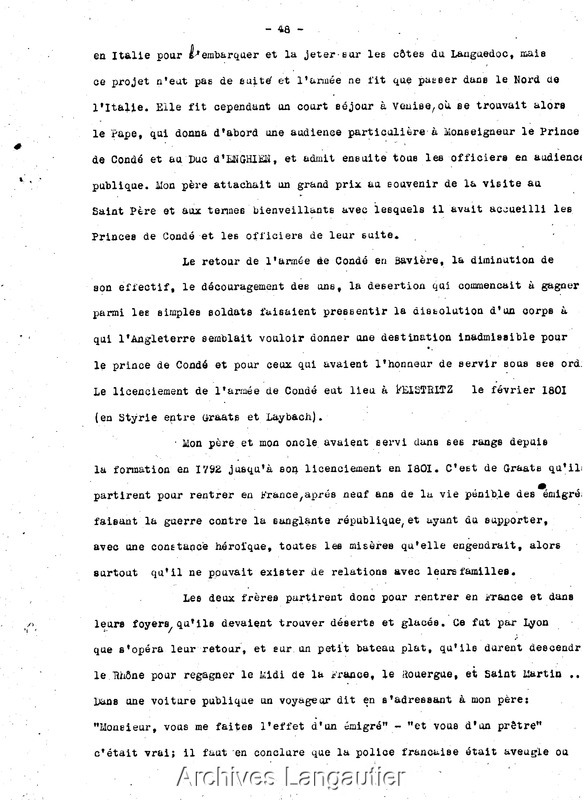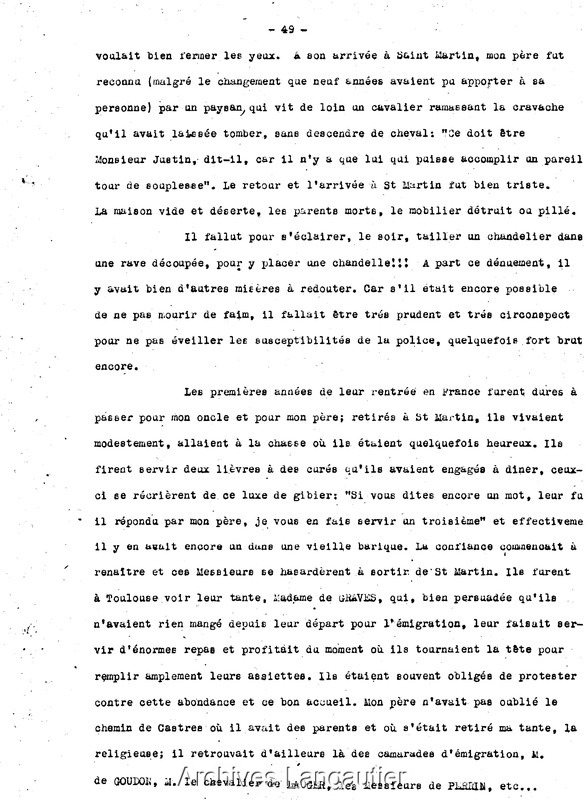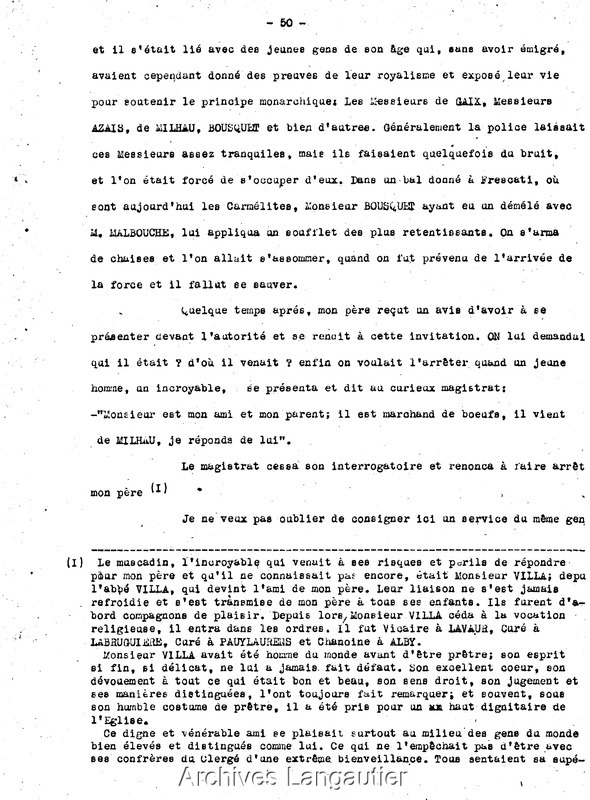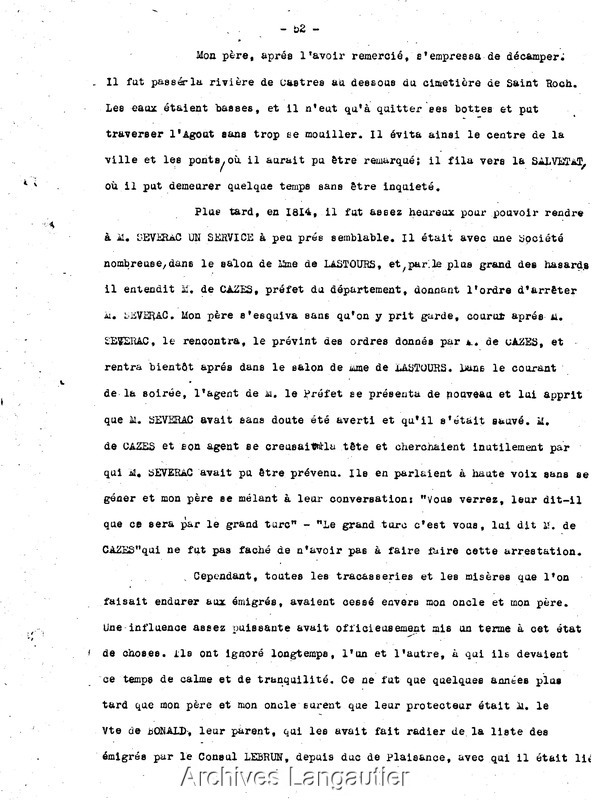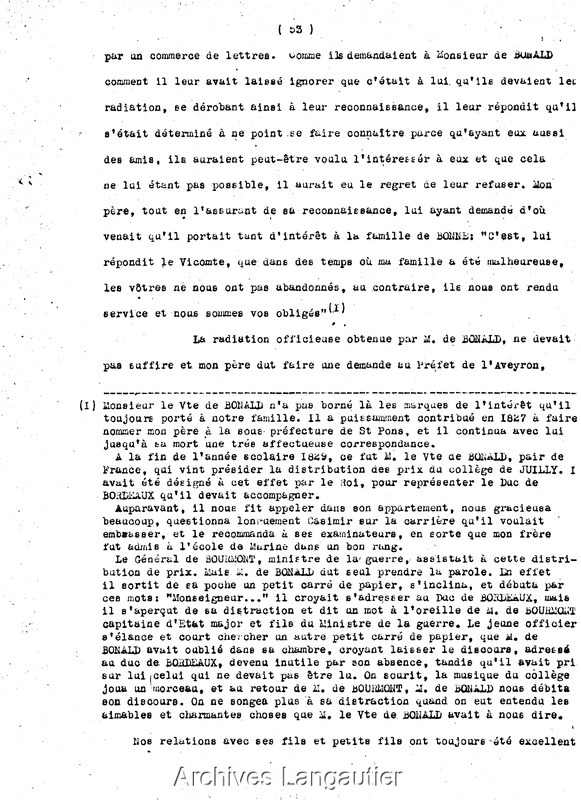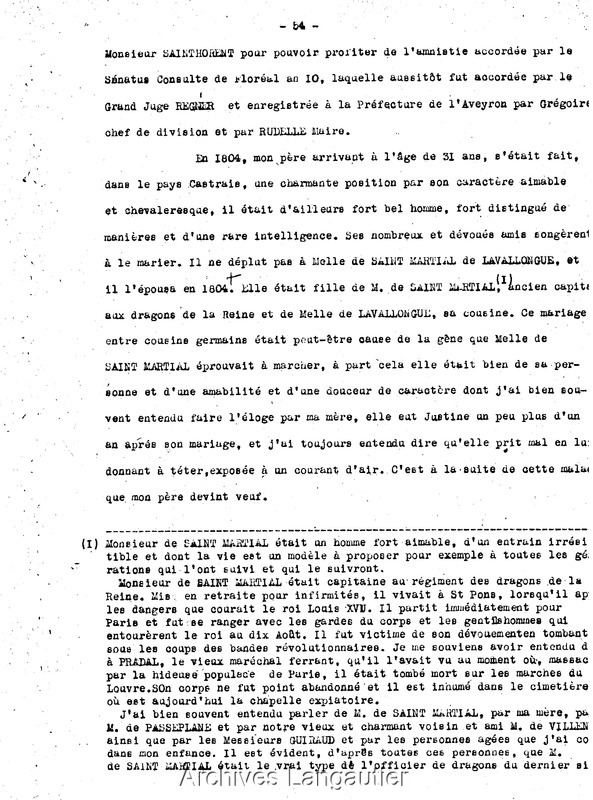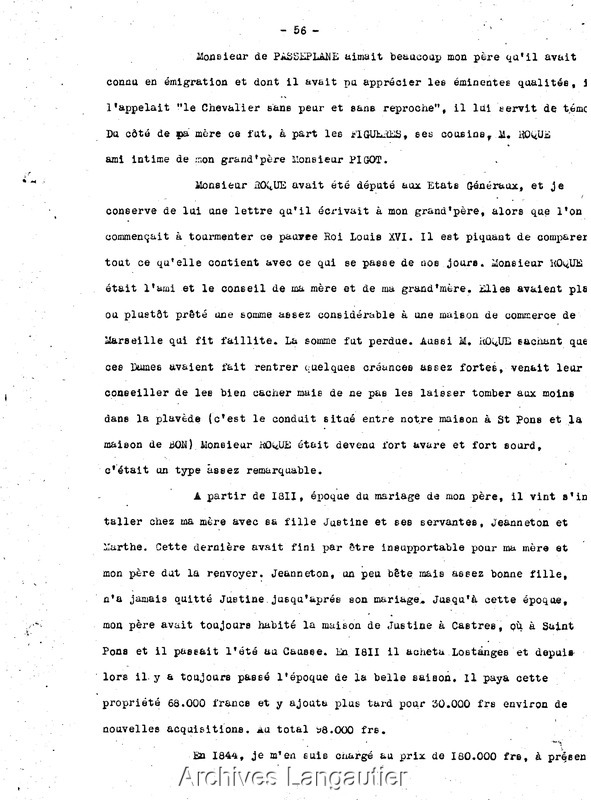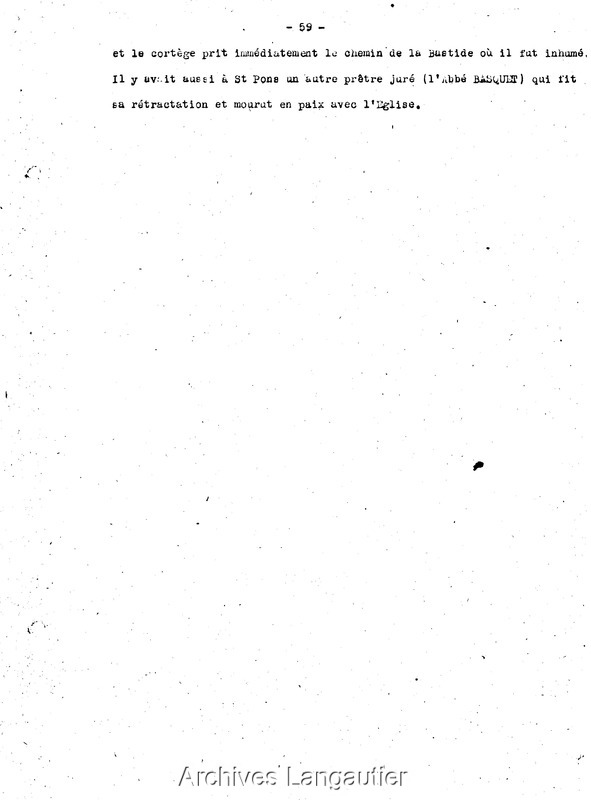Justin de Bonne
années d'émigration Création avril 2011
En 1792, Justin, âgé de 18 ans va rejoindre les émigrés qui se battent pour rétablir la royauté. Il sera de tous les coups durs et ne reviendra en France qu’en 1801, soit après 9 années de campagne.
Par son fils Louis de Bonne, vers 1870


Le respect et la vénération, dont je suis pénétré pour la mémoire de mon père, m’ont depuis longtemps, inspiré la pensée d’écrire tout ce que mon cœur et ma mémoire pourraient me fournir, non seulement sur les soins éclairés, l’éducation qu’il nous a donnée sur la direction qu’il a imprimée à tous les membres de la famille, par le temps où nous avons vécu autour de lui dirigés par les conseils et les exemples et témoins de l’estime et de la considération dont il était entouré pour tous ceux qui de près ou de loin, avaient eu, ou avaient encore, des relations avec lui.
Je veux rappeler en outre les souvenirs de son enfance, de sa jeunesse et de son émigration pendant laquelle ses hautes qualités l’avaient fait distinguer et aimer de ses amis, de ses chefs, des princes sous les ordres desquels il eut l’honneur de servir et particulièrement de Monseigneur le duc d’Enghien qui l’avait pris en affection et qui le traitait toujours comme un ami et un camarade. Ces hautes relations, dues à la bienveillante appréciation de cet infortuné prince, avaient fait de mon père un homme d’une distinction rare. Je suis persuadé que dans la famille chacun sera heureux de se remettre en mémoire tous les souvenirs qui se rattachent à lui, et y trouvera des exemples à suivre et à imiter.

Je ne pense pas que ce soit ici le cas de tracer la généalogie de la famille ; elle se trouve au complet dans l’histoire des grands officiers de la couronne. Toute la parenté peut y trouver de quoi se mettre au courant de notre origine, de nos alliances et de tout ce qui peut avoir quelque intérêt pour nous seuls, car il faut avoir toujours présent ce mot de à qui monsieur…,…., parlait de ses ancêtres, et qui répondit sur le champ : « Je me f…. de mes ancêtres, à plus forte raison des vôtres ».
Je crois cependant qu’il ne faut pas s’en tenir tout à fait à cette appréciation par trop exagérée et il est très bon de se souvenir de ceux qui, nous ayant précédé, ont mérité l’estime des gens de bien par leurs qualités et leur conduite. Mais, par le temps qui court, ou toutes les supériorités sont jalousées, il faut souvent se faire pardonner ou son nom, ou sa fortune, son intelligence, ses talents, ses avantages extérieurs (ceci regarde plus particulièrement les femmes) autant de biens qui sont généralement contestée ou ridiculisée par ceux qui ne les possèdent pas.
L’enfance de Justin
Il faut pourtant bien, en commençant à parler de mon père, dire qu’il fut le, fils cadet de monsieur Félix, Sébastien de Bonne et de Mme Marie Élisabeth de Cabrol de Grualgues, qu’il naquit le 28 novembre 1773, au château de Saint-Martin de Cassagnes, arrondissement de Rodez, département de l’Aveyron. Il eut pour parrain François Jourdan berger, habitant Saint-Martin, au nom de messire haut et puissant seigneur Melchior du Lac, Marquis du Lac, ancien colonel du régiment de Lorraine Dragons, maréchal de camp, ancien page de Louis XV, seigneur de Labruguière, parrain et cousin germain du nouveau-né, baptisé au nom de Pierre, Joseph, Justin de Bonne.
La mère du marquis du Lac, et la mère de mon père étaient deux sœurs, demoiselles de Cabrol de Grualgues ; c’est par elles qu’existe la parenté entre nous et les du Lac, les Montredon, les de Grave, les de Naujac et les de Raynaud de la Salvetat.

Mon père se souvenait de son parrain, le Berger Jourdan, et nous racontait avec plaisir qu’il en avait reçu en cadeau un agneau qui avait fait son bonheur, tandis que de son parrain le Marquis du Lac, il n’avait jamais rien eu.
Son frère François, de deux ans son ainé, avait été envoyé à Soreze entre 10 et 16 ans.Le coût de la scolarité était pris en charge par l’armée, pour peu qu’on puisse justifier de sa noblesse, d’états de services et de son indigence. Mais cela ne valait pas pour les fratries.
Son enfance se passa au petit château de Saint-Martin en Rouergue. Quand il fut en âge d’étudier, ère ainé de mon père, a on lui donna un précepteur avec qui il ne faisait pas toujours bon ménage. Bien jeune encore ce cuistre lui adressa quelques observations d’une façon légèrement impertinente. On se trouvait en ce moment dans une vigne, le jeune élève saisit un échalas et brisa sur la tête de son précepteur d’où le sang jaillit immédiatement en abondance. L’élève se sauve, est bientôt rattrapé et conduit devant son père qui le condamna su cachot et au pain et à l’eau. Il fallut s’exécuter et obéir. Mais cette punition fut tempérée par la bienveillance d’une cuisinière qui portait au prisonnier plus que du pain sec, et qui lui rendit un peu courage en lui racontant que son père ne devait pas être si fort irrité puisqu’elle l’avait entendu dire à un de ses amis : « Au surplus cet enfant a bien fait, son précepteur n ‘est qu’un brutal et un mal élevé ».
On lui fit bientôt grâce et cette première incartade oubliée il ne resta dans l’esprit de chacun que l’affirmation d’un caractère énergique qui ne s’est jamais démenti.
Ce précepteur, dont j’ai oublié le nom, était effectivement fort mal élevé, il se permit un jour de faire observer à un de mes grands oncles, qui était garde du corps en congé à Saint-Martin, que les cartes avec lesquelles on jouait une partie n’étaient pas propres. Le garde du corps trouvant cette réflexion très impertinente le traita indignement, lui rappelant que si les cartes étaient encore plus sales elles seraient toujours assez bonnes pour lui.

Le cuistre dut dévorer cette leçon qu’il trouva dure et sévère. Il s’en vengea plus tard, pendant la révolution il se signala comme un des plus farouches terroristes de Rodez et du Rouergue.
En nous racontant se dernier trait, mon père nous recommandais toujours la modération et la politesse, blâmant, tout en trouvant de excuses, la violence de la leçon que son oncle avait, infligée à sou précepteur de fâcheuse mémoire.
Mon oncle , frère ainé de mon père, avait quelques années de plus que lui. Il avait été admis à l’école militaire de Sorèze, et trouvait officier régiment de Touraine, commandé par Monsieur le Vicomte de Mirabeau, en garnison à Perpignan. Dans cette garnison il était parfaitement accueilli dans la famille de Coma, en raison de sa parenté avec les Montredon. Mon père, étant plus jeune, n’était pas sorti de Saint-Martin quand éclata la révolution. Je lui ai souvent entendu dire que son grand-père, ancien page Louis XIV, et qui était sourd à ne rien entendre, avait cependant, malgré son grand âge et a vie retirée à la campagne, parfaitement compris que les parisien s’étaient révoltés contre le Roi, il affirmait que Louis XIV n’aurait pas été d’aussi bonne composition que Louis XVI. Ce bon vieillard manifestait une profonde répugnance pour la cocarde tricolore qui commençait déjà à circuler dans ces campagnes.
François de Bonne, 1771-1827
Chevalier de Saint-Louis, Sous-lieutenant au régiment de Touraine 11 août 1786, émigré, capitaine à la légion Mirabeau, puis au régiment de grenadiers de Bourbon, sous-préfet de Saint-Pons, père de Félix de Bonne, du Curé de Saint-Pons, et de Justin de Bonne.
Louis
Élève à l’école royale militaire de Sorèze de 1781 à 1786, sous-lieutenant au régiment Touraine Infanterie le 11 août 1786, capitaine le 10 mai 1792 dans la légion de Mirabeau, armée de Condé, chef de bataillon en 1816, sous-préfet de Saint-Pons-de-Thomières le 8 juin 1823
Les sorèziens du siècle 1800/1900 – Privat éditeur. Internet.
Mais, pour en revenir à, mou père, je me reporte à l’époque où, sortant à peine de l’enfance, il s’amusait encore à se jeter dans les eaux du Viaur à la suite des bœufs que l’on conduisait à l’abreuvoir, leur saisissant la queue et se faisant remorquer dans les eaux profondes de cette charmante rivière.

Il n’avait guère plus de 18 ans lorsque les frères du roi, sortis de France essayèrent de former l’armée des princes, en I791, avec des gentilshommes, des officiers, des chevaliers de Saint-Louis, obligés de quitter leurs régiments révoltés et la France, où ils étaient poursuivis et traquée par les démocrates. Malgré son jeune âge, il se décida à aller rejoindre les officiers du régiment de son frère ainé qui servait dans Touraine et qui avaient été obligée de s’expatrier.
Il convient cependant de placer ici, quelques souvenirs qui peuvent donner l’idée des mœurs de cette époque : ainsi par exemple les relations de parenté et de famille étaient fréquentes et empreintes de simplicité et mon père aimait à raconter la passe des Gardes du corps du roi, et les bécasses de Monsieur le Chevalier de Puel de Parlan, son parent, qui, malgré sa fortune, visitait ses parents et ses amis dans un équipage plus que modeste. C’était un type de Gascon, adroit chasseur et bon convive, il appréciait et faisait un éloge bien senti de certaines bécasses qu’on lui servit à souper lors d’une de ses visites à Saint-Martin. Le bon vin et la fatigue l’avaient plongé dans une douce somnolence, au coin d’un bon feu, et il n’en fut retiré que par l’impertinence de quelques chiens de chasse, tolérés au salon, qui lapaient avec délice ses bottes fortes amplement graissées avec du suif. La gourmandise des chiens et le réveil de monsieur de Parlan excitèrent la gaieté des convives qui prit bientôt un plus grand développement lorsque Monsieur le Chevalier, rentrant dans sa chambre, s’aperçut que quelques bécasses qu’il avait soigneusement rangées dans son porte manteau, avaient disparu. Sa stupéfaction fut grande et il lui fut difficile de se maintenir en bonne humeur quand il apprit qu’on lui avait fait la mauvaise plaisanterie de les lui enlever et de les lui servir au souper.
La passe des gardes du roi
La passe des gardes du roi avait lieu tous les ans à l’expiration du congé de ces Messieurs ; ils rentraient à Paris et à Versailles par petites troupes qui se composaient d’officiers du même pays.

Il n’y avait alors ni chemin de fer, ni malle-poste ni diligence et chacun de ces messieurs achetait un cheval, à très bas prix, et l’enfourchait pour faire la route. Arrivés à Paris, le cheval était vendu sans perte et le voyage était fait à peu de frais ; d’autant mieux que si quelques étapes occasionnaient des frais d’auberge, la plupart du temps, les gardes du corps trouvaient bon gîte et bon accueil dans les familles de leurs camarades dont les maisons ou les châteaux se trouvaient sur leur route.
Ainsi celui de ces messieurs qui se trouvait à la plus grande distance le Paris, avait soin de partir assez tôt pour se joindre en route à ses camarades. C’est ainsi que Monsieur de Raynaud de La Salvetat allait coucher chez quelqu’un des amis, le lendemain, ils étalent deux qui venaient s’arrêter à Saint-Martin, d’où ils repartaient avec plusieurs gardes du roi qui s’y étaient rendue de leur côté, et, à chaque étape le nombre de ces messieurs devenait pus considérable et ils arrivaient par petites troupes à leur compagnie .
Cette manière de voyager, quelque peu primitive, était également adopté par les dames qui n’étaient pas en position de voyager en litière ; et, j’ai entendu raconter à Mme de Saunhac, grand-mère de ma femme, qu’elle était partie de Rodez, à l’âge de 11 ans, sous la conduite de Messieurs les Gardes du corps et la protection toute particulière de son grand ‘oncle monsieur Boissière, officier dans les gardes du corps, lorsqu’elle fut envoyée à la maison royale de Saint-Cyr pour y faire son éducation, (elle fut une des dernières élèves qui en sortant reçut la dot réglementaire de 3 000 livres) le voyage fut long et il fallut bien en accepter les fatigues, qui du reste étaient tempérées par la bonne humeur de ces messieurs qui lui disaient en riant : « Savez-vous, mademoiselle de Boissière, que la Reine n’est pas toujours accompagnée par des gardes du roi, commandés par un de leurs officiers ». À 90 ans Mme de Saunhac se plaisait à raconter ce voyage et n’oubliait pas de parler de la bienveillante et gracieuse hospitalité qu’elle avait reçue de château en château.
Avant de fixer le moment du départ pour aller rejoindre les princes sortis de France, nos grands-parents songèrent à envoyer leur fils à Montlédier voir sa grand-mère et son parrain, le marquis du Lac, sa sœur religieuse au couvent des Bénédictines à Vielmur et son oncle, Monsieur de Bonne de Montmaur colonel en retraite à Castres.

Ces diverses visites s’effectuèrent moitié à pied moitié à cheval suivant les circonstances. Partout mon père reçut un excellent accueil. Monsieur de Bonne Montmaur lui demanda ses noms et prénoms et ceux de son frère en lui disant : « Je suis fâché de ne pouvoir comme vous me mettre aux ordres du roi, mon âge avancé ne me le permet pas, mais soyez sûr que je vous suivrai par la pensée et que je ne vous oublierai pas ». Effectivement Monsieur de Bonne Montmaur (décédé le 21 janvier 1793) a laissé à ses neveux quelques légers souvenirs et a donné aux hôpitaux de Castres, à la Miséricordes, aux Séminaires et aux bureaux de bienfaisance sa maison de Castres, son château et sa terre de Montmaur qui valent plus de six cent mille francs. Par quelle influence a-t-il agi de la sorte ? C’est ce qui ne se sait pas mais qui peut se deviner.
Mon père fut voir sa sœur au couvent de Vielmur, il reçut d’elle et de Mesdames les religieuses l’accueil le plus cordial. Madame la Supérieure lui fit faire un petit gala avec sa sœur, seulement ces deux convives étaient séparés par la grille.
À Montlédier, où se trouvait sa grand’mère, madame de Grualgues, il fut fort caressé et bien traité par tons les membres de la famille du Lac ses cousins. Il fallut pourtant revenir en Rouergue, et ce fut sur un magnifique cheval d’escadron, que lui prêta le marquis du Lac, qu’il traversa Castres pour se rendre à Albi ; les belles apparences de cet animal attirèrent l’œil des démocrates de la ville qui saisirent cette circonstance pour gratifier père mon de leurs apostrophes ordinaires : « Vire, vire, aristocrate à la lanterne ! » mais le cheval était ardent, et il eut bientôt mis son cavalier à distance des cris et des projectiles de ces aimables révolutionnaires.
À son passage à Albi mon père fut rendu ses devoirs à sa tante et cousine, Madame de Naujac, Supérieure du couvent de Notre Dame, il fut parfaitement accueilli et caressé par cette bonne parente qui lui fit cadeau de six chemises et de six louis, pour l’encourager dans ses projets d’aller se mettre au service du roi.

À peine rentré à Saint-Martin, et âgé d’un peu plus de dix-huit ans, mon père partit avec le Chevalier de Curières parent et ami de la famille pour aller joindre les princes émigrés. Mais ce voyage ne put s’accomplir et il fallut songer à rentrer à Saint-Martin avec toutes sortes de précaution pour ne pas mettre en éveil la vigilance des démocrates dont ils n’avaient rien de bon à espérer. On s’arrêta prudemment chez les parents de Monsieur le Chevalier de Curières, qui laissa son jeune camarade dans une cabane où le jardinier serrait ses outils et rentra seul d’abord dans sa famille, afin de s’assurer du degré de sécurité qu’il pouvait y avoir, pour l’un et pour l’autre, à reparaître après leur départ. Tout se passa bien, la famille étal réunie et mon père y reçut la plus bienveillante hospitalité .
Monsieur le Chevalier de Curières était doué d’une grande force musculaire. Il lui était arrivé, comme au Maréchal de Saxe, de plier dans ses doigts un écu de six livres ou un fer de cheval. J’ai connu son frère, monsieur le Chanoine de Sainte Eulalie, par qui j’ai été bien accueilli à Rodez et auquel je n’ai jamais manqué de rendre mes devoirs. Ce pauvre chanoine était alors bien vieux, on m’a assuré qu’il avait une fois fait un sermon à des religieuses sur les devoirs des nourrices. Il avait une vive affection pour ma belle-sœur, Mme d’Ax, laquelle était toute jeune.
Le désir de servir la France, en servant le roi et la cause de la monarchie, ne s’était pas éteint dans le cœur de mon père, et vers la fin de l’année 1791. Il se détermina à faire une nouvelle tentative. En conséquence, il fut rejoint Monsieur le Chevalier de Pruynes, son parent, n’en portant pour toutes ressources que les six chemises et les six louis que lui avait donné sa tante, Mme de Naujac, à son passage à Albi ; et fièrement monté sur une jument poulinière qui ne devait plus revoir Saint-Martin, il quitta sa famille, avec la confiance que l’on a à 18 ans, surtout lorsque s’y joignait une belle mine et un caractère vigoureusement trempé.

C’est dans ce léger équipage que monsieur de Pruynes et mon père traversèrent les montagnes du Rouergue avec un froid tel, qu’aux environs de Langogne, au palais du roi, la glace formait des chandelles sur leur menton dont la peau restait aux glaçons quand ils se détachaient par leur propre poids.
Ce fut à Langogne qu’ils purent se refaire des pénibles débuts de leur voyage dans la famille de qui était alliée à la famille de Bonne. De là jusqu’à Lyon le voyage ne fut troublé que par quelques citoyens démocrates, toujours heureux de tracasser ceux qu’ils se plaisaient à considérer comme suspects.
Ce fut à Lyon que pour la première fois mon père eut le plaisir d’aller, comme on disait alors, à la comédie.
Les impressions d’un jeune homme de 18 ans (qui n’était jamais sorti de Saint-Martin, où il n’avait pour tous plaisirs que la permission tacite de posséder deux chiens bassets sur l’existence desquels on fermait les yeux) durent être fort vives et soulagèrent un peu le crève-cœur inséparable de tout individu qui s’éloigne pour la première fois de la maison paternelle.
Le surlendemain nos deux voyageurs sortirent de France par le pont de Beauvoisin, d’où on leur tira bien quelques coups de fusils, mais, grâce à de bons éperons, les jambes de la poulinière étaient devenues des ailes et la frontière fut franchie sans autre accident que d’entendre pour la première fois siffler quelques balles qui n’atteignirent point leur but.
Ma mémoire ne me retrace pas les divers incidents qui purent se produire depuis le moment où mon père quitta la France, par le pont de Beauvoisin jusqu’à celui où il arriva dans les environs de Worms et Biminguen, où commençait à se former le corps d’armée du prince de Condé, dont devait faire partie la légion de Mirabeau.

Monsieur le Vicomte de Mirabeau, ancien colonel du régiment de Touraine, (où plusieurs membres de la famille de Bonne avaient servi avec distinction, et où servait encore un oncle) était aussi prononcé dans ses sentiments royalistes que son frère l’était dans ceux de la révolution.
Justin, début aux cadets
C’est aux environs des cantonnements, où ce corps était en formation que mon père s’était dirigé, et, il attendait son frère qui n’était pas encore sorti de France, pour se faire connaître et présenter au Vicomte de Mirabeau. Se trouvant fort isolé, il tâchait de tuer le temps, se promenant et examinant de tous ses yeux, soit le pays où tout était nouveau pour lui, soit en suivant les exercices des troupes en rassemblement.
D’une taille élevée, vêtu d’habits et surtout d’une immense redingote confectionné à Saint-Martin par un des tailleurs les plus en renommée dans le village de Cassagnes (Rouergue), il avait un air des plus étranges au milieu de jeunes gens qui, pour la plupart avaient déjà servi ou qui du moins avaient vu le monde ailleurs que dans un petit château des montagnes du Rouergue. Son costume, son isolement au milieu de tout ce monde, sa grande taille, son mutisme le firent remarquer et la police de monsieur de Mirabeau s’occupa de lui et imagina que ce pouvait être un espion du gouvernement français. Aussi, par une belle nuit fut-il éveillé brusquement, et il se vit entouré de gens qui n’avaient point l’air de vouloir lui faire un parti. Il fut sommé de décliner ses noms et prénoms et, pour éviter d’être arrêté, de se faire réclamer par un répondant – il n’en avait pas ! ! Pressé par ses interrupteurs nocturnes de nommer enfin quelqu’un de sa connaissance, il se réclama de Monsieur de Mirabeau, ancien colonel de son frère et demanda à être conduit devant lui, ce qui fut fait.

Monsieur de Mirabeau voulut bien l’interroger, et finit par lui dire :
- « Mais enfin ou est votre frère ? »
- « Il n’est pas encore arrivé ! »
- « Et vous êtes venu comme çà tout seul ? »
- « Oui, Monsieur ! »
- « Sans vouloir l’attendre ? »
- « Oui, Monsieur ! »
- « C’est bon, J’aime les étourdis, en attendant que votre frère arrive, suivez les exercices, étudiez, mettez-vous en mesure de vous rendre utile et nous tâcherons de faire quelque chose de vous ».
Le courage de ces soldats n’étonnait pas moins que leur simplicité. Un gentilhomme arrivait au corps ; quelque fut sa naissance, son rang, son grade, il était reçu comme simple soldat, chargeait son sac sur ses épaules, prenait un gros fusil de munition, et renonçait au repos pour se consacrer tout entier à des fatigues qui ne cessaient que lorsqu’il tombait dans les combats ou entre les mains des républicains (Comte de Choulot, mémoires du duc d’Enghien).
Et alors un peu plus confiant en lui-même de se sentir appuyé par le colonel, il se mit à l’étude, suivit les exercices des troupes en formation, et apprit, ce que plus tard il devait enseigner aux autres, par les soins d’un vénérable sergent nommé la Rade, à qui il payait un grand nombre de petits verres d’eau de vie, pour se faire enseigner à marcher au pas et en troupe et plus particulièrement le maniement d’armes la théorie et le commandement. Dans ces débuts, il avait souvent à subir quelques plaisanteries et quelques quolibets de la part des officiers et des sergents ; ainsi, quand avec l’accent le plus pur du Rouergue, il commandait : « En avant, en batillo« c’étaient des éclats de rire et on le priait de recommencer, ce qu’il faisait de très bonne grâce et sans se formaliser. Cette facilité de caractère lui avait déjà fait quelques amis lorsque son frère arriva et commença ses démarches pour le faire nommer sous-lieutenant, monsieur de Mirabeau voulut bien s’y prêter de grand cœur et promit de ne point faire attendre cette nomination qui se retardait, cependant parce qu’un autre officier voulait faire nommer un de ses protégés. Il fallut que mon oncle réclamât sa promesse à son ancien colonel à, qui la mémoire ne fit point défaut.

Monsieur de Mirabeau demande aussitôt son cheval et se rend à la parade, fait ouvrir un ban et s’écrie : « Puisqu’on ne peut pas en faire un sous-lieutenant, il faut en faire autre chose ! Officiers, sous-officiers, soldats et tambours vous reconnaitrez pour votre lieutenant Monsieur Justin de Bonne, ici présent et lui obéirez…. etc. »
C’est ainsi que mon père débuta et, parce qu’on ne le nomma pas sous-lieutenant, se trouva lieutenant à son entrée dans la légion Mirabeau. Le Vicomte de Mirabeau occupa bientôt les bords du Rhin avec sa légion et ne put résister au désir que le voisinage de la France et la vivacité de son caractère lui inspirèrent, de hasarder une petite expédition. Il s’embarque à 11 heures du soir avec 60 hommes, aborde la rive française, pénètre à trois lieues dans les terres et enlève une mairie avec tout un club de jacobins qui s’étaient établis dans ce village. Il exécuta heureusement sa retraite, ce qui ne l’empêcha pas d’être mis aux arrêts par le prince de Condé pour avoir agi sans aucune permission.
Monsieur le Vicomte de Mirabeau était le frère du fameux Mirabeau, dont il était loin de partager les idées. Il racontait que son père, mécontent de voir son fils ainé tout à fait lancé dans la révolution, lui écrivait en ces termes : « Mon fils, si les coups de bâton pouvaient s’écrire vous recevriez ma lettre sur le dos ».
Monsieur le Vicomte de Mirabeau était énorme, aussi l’appelait-on Mirabeau-tonneau. Il le savait, et ne s’en fâchait pas. D’une bravoure à toute épreuve, il ne tenait aucun compte des coups de fusils et des coups de canon, il les bravait quelques fois même avec Mme de Mirabeau qu’il conduisait dans des endroits forts exposés aux mauvais coups et, à la façon des héros d’Homère, il apostrophait les ennemis. « Le voilà, (s’écriait-il) le voilà ce Mirabeau-tonneau tirez dessus sacrebleu… tirez dessus, il se f…. de vos coups de canon comme d’un coup de chapeau », et toujours en vain.

À partir du moment où mon père fut incorporé dans la légion de Mirabeau en qualité de lieutenant, les souvenirs de ses aventures, à l’année de Condé ne me reviendront pas toujours dans un ordre chronologique aussi les raconterais-je, tout simplement comme ils se présenteront à ma mémoire.
Le Duc de Bourbon et le duc d’Enghien vinrent rejoindre l’armée de Condé, et ce fut peu de temps après, qu’elle fut sur le point d’être licenciée. Cependant elle fut reformée à l’autrichienne, placée soue les ordres du Général Wurmser et commença à être employée au mois de mai 1793 dans les environs de Ger… où elle se retrancha.
Le comte de Viomenil commandait l’avant garde de l’année de Condé à laquelle était opposée Custine général républicain.

La légion de Mirabeau sortie de Hert…, s’était imprudemment avancée, quatre pièces de canon se portèrent en avant avec tant de rapidité qu’elles furent enveloppées et prises par quarante cavaliers républicains. Monsieur de Chorbonel commandait cette artillerie. Il périt, victime de son audace et fut massacré sur ses canons qu’il cherchait à défendre avec sa faible escorte. Dans ce terrible moment un cavalier républicain lui dit de demander quartier.
« Nous l’accordons quelquefois, répondit-il, mais nous ne le demandons jamais ». Les canons furent repris par la légion Mirabeau.
Les armées alliées étaient commandées par Wurmser pour les Autrichiens, et par le Duc de Brunswick pour les prussiens. Ces deux généraux de deux nations rivales n’étaient pas du tout disposés à s’entendre et leurs opérations ne marchaient pas avec ensemble. Ils s’avançaient cependant et l’armée de Condé dut séjourner quelque temps à Balberoth. C’est dans cette localité que mon père reçut le cadeau d’un jeune chien auquel il donna le nom de Balberoth et qu’il dressa d’une façon merveilleuse. Cet intelligent animal avait fini par chasser admirablement, surtout aven un chien de Monseigneur le Duc d’Enghien, qui admettait souvent mon père à ses parties de chasse. Le chien Balberoth était connu de toute l’armée et mon père en refusa souvent beaucoup d’argent, tant était appréciée son intelligence et surtout son aptitude à chasser avec le chien du prince, cette dernière qualité le faisait rechercher par ses personnages désireux de lui faire leur cour. Ce chien Balberoth, auquel mon père était attaché, fut l’occasion d’une scène de violence qui pouvait avoir des suites fâcheuses, mais qui finit par tourner à bien. Appelé par son service à la mairie d’une petite ville, y faire les logements, mon père causant avec le maire ou le bourgmestre ne s’occupa pas de son chien qui l’avait suivi, sortant de la mairie, il siffle son chien qui ne se montre pas, il revient au bureau où il avait eu affaire, réclame son chien dont personne ne put lui donner de nouvelles.

Il se fâche, s’emporte et perçoit sur le sol les traces de pattes de son chien se dirigeant vers une porte, il s’élance, enfonce la porte d’un coup de pied. Balberoth s’échappe et lui saute dessus pour le caresser, sa colère se traduisit en injures et en menaces qui pourtant n’arrivèrent pas aux voies de fait, le chien était retrouvé, la colère se calma et les employés de la mairie, convaincus d’avoir voulu voler le chien, durent dévorer leur honte et l’humiliation d’être si mal traités.
Au mois de septembre on songea à attaquer les lignes de Wissembourg qui bientôt après furent enlevées, en partie, par l’armée de Condé et à la prise desquelles la légion de Mirabeau eut beaucoup à souffrir étant toujours à l’avant garde et bien moins ménagée que les différents corps entièrement composés de gentilshommes. Les lignes de Wissembourg étaient défendues par le général Carleuc qui était originaire de Saint-Pons. Où mon père le retrouva plus tard (je me souviens très bien de lui). La veille de l’attaque des lignes de Wissembourg, Monsieur Carleuc était depuis fort peu de temps capitaine de dragon mais, comme à l’armée française se trouvait un représentant du peuple mécontent du général qui la commandait (général Hoche) il institua le capitaine Carleuc général en chef.
Des positions de l’armée de Coudé, on voyait ce qui se passai dans les lignes françaises, et l’on put suivre les détails du cérémonial suivi en cette occasion. Le représentant du peuple faisait mettre les troupes sous les armes ; on ouvrait un ban et le capitaine Carleuc était reconnu colonel. Quelques heures après, une nouvelle cérémonie pour le faire reconnaître général ; et enfin général en chef. Naturellement le général Carleuc fut battu, et envoyé à Paris, à la Convention, et il eut toutes les peines du monde à sauver sa tête. De Wissembourg l’armée de Condé fut bientôt arrivée devant Haguenau, où elle resta trois mois campée devant la ville qui fit très bon accueil aux princes et à leur armée.

Le deux décembre I795, eut lieu le premier combat de Berstheim . Comme toujours l’armée de Condé fut placée par les Autrichiens dans les positions les plus hasardées. La légion de Mirabeau était l’avant garde et les autrichien à occupaient Reichshoffen de douloureuse mémoire ! ! !
L’artillerie foudroie le village de Berstheim, l’infanterie s’approche pour s’en emparer, elle est reçue par le régiment de Hohenlohe et la légion Mirabeau. Repoussée, elle revient à la charge, on ne cède pas. Pressés de toute part par le feu meurtrier des batteries les braves soldats de Condé après avoir longtemps maintenu leurs positions sont rejetées hors du village. Les républicains y pénètrent aux cris de : « Vive la République, vive la Convention ».
Le prince de Condé jugeant que ce premier succès de l’ennemi peut décider de la journée, met l’épée à la main et se place à la tête de quelques bataillions. On se précipite sur ses pas, à travers le feu de l’ennemi, qui se voit arracher la victoire par cette charge audacieuse. Tout cède devant ce chef intrépide. Le village est enlevé et les républicains sont contraints de se retirer à leur tour, repoussés aux cris de : « Vive le Roi ».
Le Duc d’Enghien, avec cette ardeur téméraire qui le précipitait partout où il y avait du danger, voyant son mouvement arrêté par la direction d’une batterie qui l’incommodait, s’élance à la tête d’un détachement en s’écriant : « En avant au galop », la batterie fut enlevée et cette action lui valut la croix de Saint-Louis.
Au combat de Berstheim, les trois générations de Condé jouèrent un beau rôle . Le vieux prince de Condé chargea à la tête des régiments nobles et, aux cris de : « Vive le Roi », électrisa si bien toute sa noblesse qu’il reprit le village déjà tombé aux mains des républicains.
Condé, Bourbon, d’Enghien se font d’autres Rocroi, et, prodigues d’un sang chéri de la victoire, Trois générations vont ensemble à la gloire
Delille

Le duc de Bourbon (son fils) fut blessé à la main dans une charge à la tête de la cavalerie noble, et le jeune duc d’Enghien (son fils), à qui l’on n’eut à reprocher qu’une trop grande audace, se trouva entouré de cavaliers ennemis auxquels il résista seul jusqu’à ce qu’il puisse être secouru.
Le village de Berstheim fut encore attaqué, le 8, par l’armée républicaine et défendu de nouveau, par le vieux prince de Condé, devant lequel régiments nobles durent croiser la baïonnette pour l’empêcher de marcher à leur tête. Cette seconde défense fut encor heureuse, mais Wurmser et Brunswick ne s’entendant pas, les plans de ce dernier ne furent pas suivis et, à la fin de décembre, après de pertes très considérables éprouvées par les Autrichiens, il fallut se retirer au-delà des lignes de et repasser le Rhin.
Messieurs les émigrés parlaient volontiers des affaires de Berstheim.
J’en ai entendu le récit, entre autres par Auguste de Bonald grand ami de mon père, qui s’était trouvé (lui tout petit de taille) aux prises avec un grand tambour major ennemi dont il avait fini par avoir raison.
Quant aux lignes de Wissembourg, mon père en parlait volontiers et monsieur de Passeplanne me disait quelquefois : « la première fois que j’ai eu l’honneur de voir Monsieur votre père c’était aux lignes de Wissembourg où il avait un coup de feu à la corne de son chapeau ».
L’échec, qu’avait subi le général Carleuc fut bientôt réparé et les succès constants du général Pichegru forcèrent le armées alliées à se mettre en retraite. Quand la légion Mirabeau traversait Wissembourg un bourgeois de cette ville placé sur sa porte, interpella mon père en lui disant : « Eh bien, monsieur l’émigré, vous voilà de retour, mais n’allez donc pas si vite « , il reçut en réponse un vigoureux coup de sabre.

Cette retraite fut meurtrière pour l’armée de Condé, un officier de Mirabeau, nommé Martinel, mortellement blessé, supplia mon père de ne pas le laisser tomber aux mains des républicains ; il eut le temps de le faire hisser et attacher sur un canon qui partit de suite au galop, mais ce pauvre blessé succomba bientôt après.
Dans cette retraite précipitée, tout le monde ne montra pas la même énergie. Un capitaine qui commandait une compagnie des grenadiers de la légion de Mirabeau (que mon père ne nommait pas) et qui s’était toujours très bravement conduit jusque-là, perdit la tête, fut pris de vertige, et décampa en courant, sous les yeux de ses grenadiers, qui lui criaient : « Mais restez donc, mon capitaine, revenez à nous », et ils marchaient comme à l’exercice, leurs supplications furent vaines, il disparut et on ne l’a jamais revu ; mon père dut prendre de suite le commandement de cette compagnie qui continua de marcher avec autant d’aplomb et de calme qu’à la parade. C’est à ce moment critique, que mon père aperçut à une portée de fusil, un petit vieillard, chevalier de Saint-Louis, faisant le coup de sabre contre un grand diable de hussard républicain ; le hussard eut vite raison de son adversaire. Renversé de son cheval ce pauvre vieux brave, couché sur le dos, s’escrimait de son épée et de ses jambes pour parer les coups de pointe de son adversaire. Il aurait bientôt succombé si mon père, s’emparant du fusil d’un grenadier, n’eut tiré sur le hussard ennemi qu’il manqua deux fois. Le vieux chevalier de Saint-Louis se débattait toujours et parait de son mieux. Un sergent de Mirabeau tire à son tour sur le hussard et le tue. On s’empresse de courir au chevalier, on le relève, et il s’écrie aussitôt en patois : « As bist couçi parabi » (as-tu vu comme je parais) ce, devait être un vrai cadet de Gascogne.

Ce fut en passant sur les hauteurs de Wissembourg que mon père vit réunis les généraux de Brunswick, Wurmser et les princes qui commandaient les armées et assistaient à leur retraite.
L’année 1794 se passa sans de grands évènements militaires pour l’armée de Condé. Elle eut ses cantonnements sur les tords du Rhin dans différentes localités de la rive droite de ce fleuve, à Rotemborn, à Rasta, à où une tentative fut faite pour passer ce fleuve mais elle n’eut pas de succès.
Ce fut pendant l’hiver très rude de cette année que les malheureux eurent à souffrir du froid et de la pitoyable nourriture à laquelle les condamnait le manque de ressources .
La paie des gentilshommes était celle des simples soldats ; sept sols par jour. On trouva moyen d’augmenter cette somme insuffisante pour ceux qui n’avaient d’autres, ressources : on forma une masse des appointements de chaque grade, à commencer par celui des princes, et on fit à tous une égale répartition.
Des accidents fâcheux occasionnés par la similitude des uniformes de l’armée de Condé et de l’armée républicaine déterminèrent en changement dans l’uniforme des troupes du prince de Condé pour lesquelles on adopta la couleur gris de fer.

Ce fut en 1794 que monseigneur le Duc de Berri se rendit à l’armée de Condé, et que mon père eut l’honneur de servir sous ses ordres
Monsieur de Damas, son gouverneur, était près de lui, voyant la décoration de mon père, il lui demanda où il avait servi et mon père lui répondit : « À l’armée de Condé, pendant un certain temps sous les ordres de monseigneur le duc de Berri, et pendant longtemps sous le commandement plus direct de monsieur le comte Roger de Damas ».
Pendant la visite que noue fîmes au duc de Bordeaux à Saint-Cloud, le prince, alors tout enfant, son gouverneur, son sous-précepteur et tous ses entours furent fort gracieux pour Monsieur d’Escorbiac, auquel ils firent beaucoup de questions sur le collège de Juilly et pour mon père, qui n’ayant trouvé aucun huissier ou valet à qui remettre sa canne, s’excusait de cette liberté qui frisait le sans-gêne ou qui du moins violait les lois de l’étiquette ; on le rassura de la manière la plus bienveillante et la plus gracieuse.
Pendant notre visite, le prince eut celle de trois enfants de son âge dont l’un portait le bras en écharpe, il fut pour eux gracieux et caressant autant que possible. C’étaient les trois enfants du duc de Guiche, qui plus tard se sont rattachés : l’ainé à l’empire et qui n’a marqué qu’au moment de la déclaration de guerre 1870 (triste célébrité), le second est devenu général sous les d’Orléans, et le troisième assez lié avec Henri (Henri de Bonne, lieutenant-colonel au 93e de ligne 1817-1898) se plaignait de la manière dont sa famille avait été traitée par les Bourbons. C’était dans un café, Henri lui rappela les faveurs dont tous les Gramont avaient été l’objet le réduisit au silence. Devenu colonel, sous l’empire, il a eu un bras emporté au début de la guerre à Reischoffen, il devint général de brigade. C’est sans le moindre scrupule qu’il avait épousé la fille du tristement célèbre duc de Praslin, qui du reste était charmante.
Voilà une famille qui n’a pas donné un grand exemple de fidélité au roi et dont un des membres s’est montré peu délicat en épousant la fille d’un assassin.

La fidélité ne chancelait pas, dans l’armée de Condé, même devant la misère, car pendant ces rudes hivers de 1794 et 1795, les émigrés ne faisaient pas bonne chère, souvent même ils crevaient de faim, couverts de vermine acceptant gaîment une ration de pain noir sur lequel ils étendaient un peu de beurre rance. Ils avaient quelquefois recours à la chasse pour améliorer leur ordinaire. Ils étaient presque tous d’habiles tireurs, mais le plus remarquable d’entre eux était monsieur le chevalier de Rivals de Boussac qui ne manquait jamais une pièce de gibier, aussi lui confiait-on toutes les provisions de poudre et de plomb que l’on pouvait se procurer et l’on était à peu près sur d’avoir un supplément d’ordinaire quand ils se mettaient en chasse .
Les jours de jeune et de misère revenaient bien souvent aussi pour couper quelquefois l’ordinaire, plus que frugal des émigrés, monseigneur le duc d’Enghien envoyait son valet de chambre Joseph avec ces mots toujours bien accueillis : « Allez chez les Gascons et dites leurs qu’aujourd’hui chez eux la marmite est renversée », c’était sa manière de les inviter à sa table.

Cette coterie de gascons se composait de Monsieur d’Escorbiac, baron de Villauget, de Monsieur de Bonne, Monsieur de Perrin, du chevalier de Raynaud de Martinet et de plusieurs autres dont les noms ne me reviennent pas.
Le chevalier de Martinet, fort original et d’un caractère fort indépendant, fit répondre un jour au prince qu’il avait diné et qu’il restait chez lui ; et il y resta en effet malgré les observations de ses camarades et de ses amis. Il lui en prit, car le prince l’envoya chercher par ordre, et lui dit qu’en l’invitant il ne le forçait pas à manger mais qu’il lui faisait l’honneur de l’admettre à sa table. Le chevalier de Martinet était et a toujours été un grand original, sur le compte duquel il a n bon nombre d’anecdotes fort plaisantes ; il était fort brave et se permettait quelquefois de chevaucher au petit galop de son cheval blanc, sans s’inquiéter des coups de fusil auxquels il servait de point de mire. Aux observations qu’on pouvait lui faire sur ces imprudences gratuites, il répondait qu’il allait acheter un petit pain pour son déjeuner. Il s’était de cette façon délivré un certificat de bravoure, que personne ne s’avisa jamais de lui contester. Il aimait beaucoup mon père et, pendant une maladie grave qu’il eut en émigration, il l’avait institué son héritier. Heureusement pour lui il se rétablit et mon père lui fut toujours très dévoué. Les jeunes officiers lui reprochaient son indifférence pour les biens de ce monde à l’occasion surtout d’une circonstance où l’avant garde de l’armée de Condé était entré dans une ville d’Alsace. Le chevalier de Martinet et mon père s’étant rendus à la mairie, pour leur service, virent une table couverte d’assignats, auxquels ils ne touchèrent pas. Plus tard des jeunes gens disaient au chevalier : « Il est tout simple que de jeunes officiers n’aient pas songé à faire une bonne provision d’assignats, mais un vieux routier comme vous n’est pas pardonnable de laisser échapper les bonnes occasions que lui offrent les chances de la guerre ».

Il y avait aussi à l’armée de Condé monsieur de Raynaud de La Salvetat, ancien garde du corps, cousin du chevalier, et père de monsieur vicomte Auguste de Raynaud qui est mort l’an dernier à l’âge de 80 ans .
Le roi Louis XVIII faisait un jour compliment à monsieur de Raynaud sur son dévouement au roi.
« Sire, répondit-il, j’étais sujet avant d’être père et époux ».
En effet il avait été père avant d’être époux. Car étant très épris de mademoiselle de Saint-Martin qui l’aimait aussi beaucoup, leurs parents ne voulaient pas les unir et ils crurent pouvoir se passer de leur permission ; il en résulta une grande colère de l’abbé de Saint-Martin qui voulut faire enlever le fruit de cet attachement et le faire disparaître.
Cela ne faisait pas du tout l’affaire de ces jeunes amoureux, et chaque nuit Monsieur de Raynaud battait l’estrade autour du château de Bonneval, où sa belle était enfermée avec mademoiselle Figuères (ma tante), qui seule lui resta fidèle dans cette délicate circonstance.
Un beau soir enfin l’éclat d’une lumière placée sur une des fenêtres de l’habitation fut le signal de la naissance d’un garçon, et de son enlèvement par un des estafiers de l’Abbé de Saint-Martin. Notre héros le cherche, l’aperçoit et court sur lui l’épée au vent, en s’écriant :
« Arrête, malheureux, tu portes le sang des Raynaud ».
Il s’empare de l’enfant, l’enveloppe dans son manteau, et va le confier à ses sœurs qui le gardent caché à La Salvetat, pendant deux ans.
Les jeunes gens furent enfin mariés et ont vécu longtemps unis et heureux. Leur fils devint un beau jeune homme, garde du corps à la restauration, puis officier d’état-major, aide de camp du duc de Mouchy, et surtout un homme aimable, instruit et véritable type des manières et des façons distinguées des gentilshommes de la restauration.
Monsieur Auguste de Raynaud, très fat dans sa jeunesse, était devenu très bienveillant, il était de l’académie des jeux floraux à Toulouse et avait été la coqueluche des jeunes demoiselles de son temps.
Monsieur de Raynaud avait été garde du corps du roi Louis XIV avant la révolution. Il avait débuté, en émigration, par aller à Mitau. Mais l’armée des princes fut dissoute, et l’on vit un jour à l’armée de Condé apparaitre un personnage de haute taille, portant une grande écharpe blanche, en sautoir, brandissant un fusil dont il frappait vigoureusement le sol, en s’écriant : « Le canon réveille le braves, me voici ». Telle fut l’arrivée de Monsieur de Raynaud à l’armée de Condé. Cette entrée en campagne était un peu théâtrale et dans ses habitudes de vrai gascon, très fin, très spirituel et très aimable.

Il avait trouvé le moyen d’être payé par la solde russe et par la solde anglaise ; il eut des scrupules de prendre ainsi des deux mains et crut devoir faire résoudre ce cas de conscience et de délicatesse par monseigneur le duc de Bourbon, qui réfléchit un instant, et lui dit : « Bath… ce sont les anglais qui payent, prenez toujours ».
Les émigrés n’avaient jamais de nouvelles de leur familles ce qui était pour eux une grande privation et une peine ajoutée à tant d’autres. Cependant mon père eut l’occasion par deux fois de savoir ce qui se passait chez ses parents. Une fois, en interpellant un soldat d’un poste avancé de l’armée républicaine, une autre fois, par Monsieur de Pins.
Les soldats des deux armées s’interpellaient mutuellement, et l’un d’eux s’adressant à un soldat de l’armée de la république, à travers une rivière qui les séparait :
- « D’où es-tu, toi ? » cria-t-il.
- « Je suis du Rouergue ! »
Tiens c’est assez curieux, se dit mon père qui les écoutait et qui prit la parole :
- « Et de quel endroit ? »
- « De Cassagnes ! »
- « Alors tu sais où est le château de Saint-Martin ? »
- « Et certainement ! »
- « Et qu’est-ce qui s’y passe ? »
- « Monsieur de Bonne le vieux est mort, ses fils ont émigré, la religieuse chassée de son couvent se cache chez des paysans. Le château a été pris et saccagé par les républicains, mais non pas sans résistance, car monsieur le chevalier de Seriex s’est crânement défendu, mais il a été trahi, on l’a pris et exécuté sur la place de Rodez et l’on a forcé les dames à assister à son exécution. »

Ces tristes et terribles nouvelles furent les seules que mon père et de sa famille d’où il n’avait pris que la fameuse jument poulinière, les six chemises et les six louis que lui avait donné sa tante, Mme de Naujac Supérieure du couvent de Notre-Dame à Albi.
Monsieur de Pins , père d’Antonin et de Raymond, rejoignit à cette époque l’armée de Condé, et donna des nouvelles de leur famille a beaucoup d’émigrés.
Monsieur de Pins avec un esprit infini ne dirigeait pas très bien ses affaires, aussi a-t-il été gêné toute sa vie. Si bien que se trouvant en retard pour paiement de ses contributions, il reçut un papier timbré très pressant du percepteur qui l’engageait à venir se mettre en règle. Le percepteur s’appelait Sol, aussi Monsieur de Pins se contenta-t-il de mettre au dos du billet d’avertissement : « Sol…. Sol…. cur me persequeris »et il renvoya le billet.
Monsieur de Pins avait deux chevaux qu’il avait appelés l’Impayable et l’Impayé. Avec tout son esprit il agissait de telle façon que sa mère lui disait un jour : « Ah si tu étais le fils d’une autre comme tu m’amuserais » À une époque, il avait le très grand désir d’aller s’amuser à Paris, mais il lui fallait de l’argent ; il imagina de persuader une de ses tantes, qu’il devait être présenté à la Princesse Pauline, sœur de Napoléon, mais qu’il hésitait à cause de la somme d’argent qui lui serait nécessaire pour se mettre en équipage convenable, car un de Pins ne pouvait pas se présenter comme le premier venu…. mademoiselle de Pins Rochefort, avait quelques doutes sur les assertions de son neveu, et pour les éclaircir, elle fit prier mon père de passer chez elle, et lui dit :
- « Voyez-vous, monsieur de Bonne, je ne suis point fière ni vaniteuse, mais pour de l’orgueil, quand il s’agit d’un de Pins, j’en ai comme Belzebuth… Voilà mon neveu qui doit être présenté à la princesse
Pauline, et vous concevez qu’un de Pins ne peut pas arriver là comme tout le monde, pensez-vous qu’une somme de cinquante Louis puisse suffire pour cette présentation ? Euh.., euh… bien certainement mademoiselle…. pour commencer… oui ».
Et monsieur de Pins accrocha ainsi à sa tante de quoi faire le voyage de Paris.
Monsieur de Pins avait fait sa propre épitaphe que tout le monde connait : « Ci-gît de Pins de Caucalières, âgé de soixante ans et plus, Si vous priez pour les, il a des droits à vos prières ».
Si Monsieur de Pins avait de l’esprit il en tenait une bonne part de sa mère qui était extrêmement aimable.
Je me souviens qu’étant très jeune, j’insistais auprès d’elle pour obtenir qu’elle laissât venir Antonin et Raymond à Lostange. Elle me répondit : « À Lostange vous et vos frères êtes des casse-cou et mes petits-enfants me reviendraient des cous cassés ». Son mari, monsieur de Pins avait débuté au régiment d’une terrible façon…
Arrivé tout neuf et possédant surtout l’accent le plus pur du terroir de Caucalières, ses camarades voulurent se moquer de lui et le tâter, l’un d’eux entre autres lui lançait des boulettes de mie de pain qu’il se contentait de mettre de côté avec le bout de son couteau.
Vers la fin du repas il se tourne vers le garçon, qui servait à table, et d’une voix forte, et avec son remarquable accent, il lui dit : « Garçon un pain ».
Le garçon le lui apporte, et Monsieur de Pins le lance à la face de celui qui lui avait envoyé tant de boulettes, en lui disant : »
Monsieur je vous rends en gros ce que vous m’avez donné en détail !! » Ils furent se battre, Monsieur de Pins lui appliqua un bon coup d’épée et le tua.

Seulement on n’y ajoutait pas toujours une foi entière, car lorsqu’il ignorait le sort d’un parent ou d’un ami au sujet duquel il était interrogé, il répondait invariablement : « Il est mort ». Il tué ainsi beaucoup de gens qui étaient parfaitement bien portants. Il put cependant parler à mon père de sa sœur la religieuse qu’il avait vu plusieurs fois chez ses tantes, Mesdemoiselles de Pins ; mais sa réputation d’esprit et surtout d’esprit inventif était si bien établie, que mon père ne crut pas un mot des nouvelles qu’il lui donna et qui, par exception, étaient très exactes.
C’est vers la fin de l’année 1795 que Pichegru, secrètement dévoué à la Monarchie voulut donner des preuves de son dévouement au roi, en recevant, à Strasbourg, le prince de Condé et son armée ; mais ce fut à la condition que pas un étranger, prussien ou autrichien, ne mettrait le pied sur la terre de France. Les Autrichiens firent avorter ce plan, leur désir secret étant de s’approprier l’Alsace, comme les prussiens s’en sont emparés en 1870. Cette tentative fut manquée, un armistice survint, il y eut une trêve pendant l’hiver durant laquelle beaucoup de soldats français vinrent rejoindre leurs anciens officiers.
La bienveillance de Monseigneur le Duc d’Enghien pour mon père était extrême et ne se bornait pas à des invitations à ses parties de chasse. Ayant eu maintes fois l’occasion d’apprécier ses qualités, sa bravoure, sa bonne mine, son dévouement et son caractère chevaleresque, il l’avait attaché à sa personne en qualité d’officier d’ordonnance et l’admettait pour ainsi dire dans son intimité ; à la chasse, au jeu, à sa table, à ses parties de patin, comme au combat.

Monseigneur le duc d’Enghien aimait à jouer mais non pas à perdre, quand il gagnait il avait l’habitude de plaisanter les perdants. Il arriva qu’étant admis à, faire la partie du prince, mon père lui gagna une assez jolie collection de pièces d’or, mais la veine changea, et le prince regagnait les pièces d’or qu’il avait perdues. Dès lors sa bonne humeur se traduisit en plaisanteries qu’il adressait à son partenaire qui ne riait plus : « Mon pauvre de Bonne, lui dit le prince, vous voilà à peu près à sec ». »Pas tout à fait Monseigneur, car j’ai eu soin de mettre en réserve quelques pièces d’or pour faire votre partie de demain », et en effet, en véritable gascon, mon père avait eu soin, à mesure qu’il gagnait, de glisser dans la poche de son gilet quelques-unes des pièces d’or qu’il gagnait au prince, cette prudente précaution amusa fort le prince, qui depuis en plaisantait souvent mon père.
Monseigneur le duc d’Enghien dinait un jour entouré de ses aides de camp, de ses officiers d’ordonnance et de ses jeunes amis, quand on vint le prévenir qu’un de ses postes avancés venait d’être enlevé. On quitte la table, on monte à cheval et l’on s’élance grand train pour le délivrer. Le prince était monté sur un magnifique cheval anglais qu’il appelait Belon et qui venait de lui être amené par Pelier un de ses premiers piqueurs. Il courait en tête et plaisantait ceux qui ne pouvaient le suivre et entre autres, mon père qui éperonnait de son mieux un mauvais cheval qu’il avait entre les jambes. On arriva devant un large fossé qui fut admirablement franchi par le prince, une partie de sa suite franchit également cet obstacle ; mais le cheval de mon père s’abattît en tombant au milieu du fossé pendant qu’il se débattait et tachait de remettre son cheval debout, le poste fut délivré et le prince, en retrouvant son officier d’ordonnance, prenait plaisir à s’égayer de sa chute ; mais mon père se permit de lui répondre qu’avec les chevaux qu’on lui donnait, il pourrait bien passer pour prudent s’il lui arrivait de se trouver en arrière dans les moments un peu chauds.

« Quand cela, lui dit le prince, avec votre réputation, vous n’avez rien à redouter ; au surplus, crevez vos chevaux quand ils ne vous conviendront pas, on vous en donnera d’autres et ainsi de suite jusqu’à ce que vous en trouviez un à votre convenance ». Ce procédé était parfaitement dans les gouts de mon père qui ne manqua pas de le mettre en pratique.
Ce poste délivré rappelait à mon père qu’il fut aussi sur le point d’être pris, avec un poste qu’il commandait, et qui avait été oublié pendant une nuit des plus sombres. Il s’était bien aperçu qu’on n’était pas venu le relever, comme d’habitude, et commençait à trouver la nuit bien longue, quand il fut prudemment abordé par une grande garde de cavalerie, qui croyait avoir affaire à l’ennemi. L’on allait en venir aux coups de fusils, quand on put se reconnaître et décamper au plus vite pour rejoindre le gros de l’armée, qui s’était mis en retraite, oubliant de prévenir celui de ses postes avancés que commandait mon père.
Quelque bonne garde que l’on fit devant l’ennemi, il y avait hommes assez adroits pour déjouer la vigilance la plus soutenue.
Ainsi un soldat de l’armée républicaine, voulant passer à l’armée de Condé, fut si adroit, si habile, si prudent qu’il put arriver, en rampant, au milieu d’un poste d’avant-garde, sans avoir éveillé la vigilance d’aucun factionnaire de l’une ou de l’autre armée.
Cependant l’armée autrichienne, sans cesse harcelée par l’ennemi, dut se mettre en retraite ; et l’armée de Condé était toujours occupée à la couvrir : puisque l’avant garde elle était devenue arrière garde. Ce fut alors que, dans un combat de nuit commandé par le Duc d’Enghien, se fit connaître le général de Pélissier, qui occupait un grade relativement élevé. Ses vieux camarades parlaient toujours de lui avec les plus grands éloges ; la restauration se souvint de ses services et nous l’avons vu général de division et grand-croix de Saint-Louis.

Ce fut le 13 août I796 qu’eut lieu le combat meurtrier d’Oberkamlach , où les émigrés, à quelque corps qu’ils appartiennent, déployèrent une brillante valeur. Ils éprouvèrent des pertes fort sensibles et, parmi les gentilshommes tués ou blessés qui figurent sur la liste qu’en donne Monsieur le marquis d’Ecquevilly , je retrouve une quantité de noms de ma connaissance. C’est dans cette affaire que fut tué monsieur de Boissezon, frère de l’ancien maire de Castres, que nous avons tous connu et dont le souvenir est précieux à ceux qui ont pu apprécier son esprit, sa générosité et le bon usage qu’il faisait de sa belle fortune.
Monsieur de Boissezon marchait au feu, côte à côte avec mon père, en lui disant : « Ma foi, je suis dégouté du métier que nous faisons ; nous nous battons contre la France, au profit des puissances étrangères ; à la fin de la campagne, je compte demander l’autorisation de me retirer ». II n’avait pas achevé ces mots qu’il est tué roide par un boulet en pleine poitrine.
Ce fut à Oberkamlach que fut aussi tué monsieur de Coignac, l’un des oncles de ma femme, qui servait dans la cavalerie de l’armée de Condé. Les messieurs de Coignac étaient quatre émigrés, y compris celui dont je viens de parler. Le second était officier de génie ; le troisième que l’on appelait Lodière était garde du corps et mon beau-père servait aussi dans la cavalerie noble.

Note sur l’attaque de Kamlach
Au-delà de Memmingen, l’armée étant suivi de près par un corps d’armée française, sous les ordres du général Abbatucci, Monsieur le Prince de Condé se décida à combattre ; il eut des motif pour prendre ce parti étranger au cours ordinaire des choses, car rien n’indiquait dans sa position une raison apparente pour choisir ce moment ; il crut devoir le faire et fit ses dispositions en conséquence.
(Muret t. I, page 228) (Marquis Costa de Beauregard, souvenirs tirés du comte de la Ferronnays, P 43).
Ce motif transpira jusque chez les républicains (Dedon. Précis historiques – etc..,).
Le corps d’armée dut attaquer le centre de l’ennemi sur la Kamlach, monsieur le Duc d’Enghien avec ma légion, à laquelle on joignit sept cents hommes d’infanterie, dut attaquer sa gauche à Oberkamlach et Monsieur le comte de Viomesnil, avec deux régiments de troupes légères et peu d’infanterie, inquiéta sa droite. Nous nous mîmes en route avant la pointe du jour et repoussâmes sur tous les points les avant-postes, mais en arrivant sur la chaussée de Munich, au point où elle traverse en montant un bois épais, monsieur le Prince de Condé trouva l’infanterie française supérieure à la sienne et trop avantageusement située pour la déloger. Il n’en persista pas moins et fit attaquer à la baïonnette par l’infanterie noble, dont la bravoure ne put déranger l’ordre et le calme qui régnaient dans les troupes ennemies. Il y eut à cette attaque près de sept cents gentilshommes, et beaucoup de chefs, tués et blessés, sans avoir pu obtenir le plus petit avantage.
(Mémoires du Comte Roger de Damas)

Il y avait à l’armée de Condé trois frères, les Messieurs de Corsac, originaires du Limousin.
Le baron de Corsac fut si grièvement blessé, à Oberkamlach, qu’il succomba à la suite de ses blessures. Il avait attrapé un coup de feu au genou qui l’avait mis sur le flanc. Malgré cela, il voulut continuer à boire de l’eau de vie, suivant son habitude. Les médecins, le chirurgien, ses amis, ses camarades lui faisaient observer que cette absorption de liqueurs fortes aggravait la position et l’engageaient à être plus sobre. Il levait alors sa jambe et leur disait : « Comment diable voulez-vous que l’eau de vie ne fasse rien à mon genou. Je lève ma jambe plus haut que mes lèvres, et vous savez que les liquides ne remontent pas au-dessus de leur point de départ, les lois de la physique s’y opposent ! » Le baron de Corsac but si bien qu’il en mourut. On le citait pour n’avoir jamais pu emboiter le pas à la parade, même au son des tambours, de la musique et de la grosse caisse.
Son testament est resté célèbre comme chef d’œuvre du genre, le voici : « Je lègue mon cheval à mon frère le Chevalier, mes hardes à mon grenadier et mes dettes à mon frère ainé ».
Ce testament fut accepté et exécuté. C’est à ce combat d’Oberkamlach que fut grièvement blessé monsieur de Pélissier. Du reste il n’allait jamais au feu sans attraper quelques blessures plus ou moins graves ce qui ne l’a pas empêché de vivre longtemps honoré et entouré d’une grande considération, qui après lui, s’est reportée sur Maurice de Pélissier, son fils, avec lequel j’ai conservé des relations excellentes, mais beaucoup trop rares.
Mon père qui dans cette affaire eut monsieur de Boissezon tué à son côté, ne reçut pas la moindre blessure et fut nommé le 20 août, aide major en remplacement de monsieur de Boissezon. Ce ne fut que le 18 octobre 1796 qu’il fut blessé à l’affaire de Saint-Peters. Cette blessure peu grave le laissa évanoui pendant plusieurs heures.

Il avait reçu une balle dans le cou, et, n’en fut point incommodé puisqu’il put prendre part à tous les combats qui se donnèrent dans la suite, comme à tous ceux qui avaient eu lieu depuis son entrée à la légion de Mirabeau. Cette chance heureuse provoqua, un jour, Monseigneur le duc d’Enghien, à dire à mon père :
- « Mais enfin, mon cher de Bonne, comment faites-vous donc pour n’être jamais blessé ? »
- « Monseigneur je fais comme vous ! » répondis mon père,
- « Oh oui, je le sais bien (dit le prince) mais vous êtes toujours au feu, et vous savez bien que je ne puis pas toujours y être » ce qui était vrai. Le prince savait bien que mon père ne se ménageait pas car il le voyait faire. Dans un moment très chaud, le prince lui envoya, un jour, l’ordre écrit de se trouver à tel moment sur un point d’où il fallait déloger l’ennemi. Au milieu des coups de fusils, mon père écrivit, sur le dos du billet : « mort ou vif j’y serai ! » et il s’en empara et s’y maintint. Je tiens ce dernier fait de monsieur de Foucaud, à qui il avait été raconté, par un ancien officier de l’armée de Condé attaché à a personne du duc d’Enghien.
Après le combat d’Oberkamlach, l’armée de Condé continua de battre en retraite jusqu’au-delà de Munich.
Autour de cette ville, où ne pénétrèrent aucune des deux armées ennemies, il y eut de petits combats et tous les jours, matin et soir, des affaires d’artillerie et de mousqueterie plus ou moins longues.
Mon père nous racontait qu’il avait vu une tour bâtie en briques où les boulets de l’armée de Condé faisaient des trous, comme à l’emporte-pièce ; ces trous étaient aussitôt garnis de canons de fusils qui ripostaient de leur mieux. Sur un point, peu éloigné de cette tour, un jeune tambour de l’armée républicaine battait la charge sans sourciller aux coups de feu et à la mitraille, ce que voyant, monseigneur le duc d’Enghien, défendit qu’on tirât davantage sur cet enfant si audacieux et si brave.

Du reste monseigneur le duc d’Enghien appréciait au plus haut degré les qualités et la bravoure des soldats de la république. Mon père le rencontra un jour seul, sur un cheval qui n’en pouvait plus par suite d’une foulure, il descendit de sur le sien, et le donna au prince, qui ne voulait pas l’accepter. « Ah, lui dit-il, avec l’expression du plus profond regret, comme ces gens-là se battent bien…. et quand je songe que je devrais les commander ! ! »
Dans une autre circonstance, 6 septembre 1799, pendant que Korsakoff et Masséna se battaient en Suisse, le duc d’Enghien se trouvait avec ses officiers, au château de Waldlee, sur les bords du Danube (Ce château qui appartenait aux comtes de Truxes dominait le fleuve et une immense plaine) l’on apercevait au loin quelques soldats isolés, puis des groupes et enfin des détachements plus considérables. Le duc d’Enghien donna l’ordre à ses officiers d’ordonnance d’aller voir ce que ce pouvait être. Ils montent à cheval, parcourent la plaine et reviennent enfin. Mon père s’adressant au prince, lui dit : « Monseigneur ce sont les soldats de Korsakoff qui battent en retraite devant Masséna. Le prince se frotte les mains d’un air satisfait : « Ma foi, dit-il, j’en suis enchanté » – « mais, monseigneur, cela ne vous ouvre pas le chemin de Chantilly » – « Eh bien tant pis, ces gens-là verront qu’on n’entame pas la France comme un pain de beurre ». Je viens de citer là deux propos spontanés qui révèlent bien à quel point l’amour propre national était enraciné dans l’âme du prince.
La légion de Mirabeau était passée, en 1795, sous les ordres de monsieur le comte de Damas qui, tout aussi brave que monsieur le vicomte de Mirabeau, était cependant moins téméraire. Examinant un jour une batterie ennemie, abrité lui-même par un pli de terrain où cependant les boulets arrivaient en quantité. Le factionnaire (suivant un usage alors, en Allemagne) en criant « foyer » avertissait que dans la batterie ennemie on mettait feu à la pièce.

Suivant l’usage chacun se garait en se courbant ou s’abritait de son mieux.
Monsieur de Damas faisait comme les officiera autrichiens, au milieu, desquels il se trouvait. Mais quelques jeunes officiers de la légion, au nombre desquels était mon père, affectaient de se redresser d’autant plus que les autres se baissaient davantage. Monsieur de Damas s’en aperçut et les traita avec une grande sévérité leur demandant s’ils se croyaient plus intrépides que d’autres, et s’ils avaient la prétention de lui donner une leçon. Ils furent fort penauds, et de plus sévèrement punis… lls ne l’avaient pas volé.
Dans une affaire assez meurtrière, monsieur de Damas eut son cheval tué sous lui . Il le regretta beaucoup et désirant conserver le harnachement et surtout la selle qui était fort belle.
Monsieur du Chaffaut commandait dans la légion une compagnie de cavalerie, et pour quelque méfait peu grave, pour une simple étourderie sans doute, monsieur de Damas lui enleva son commandement ; il s’en suivit des réclamations, des explications des paroles aigres, de gros mots et en fin de compte monsieur de Damas proposa une rencontre que monsieur du Chaffaut se hâta d’accepter. Le pistolet fut choisi pour combat et l’on dut marcher l’un sur l’autre ; monsieur de Damas tire le premier et abat le panache du plumet de monsieur du Chaffaut. Celui-ci marche toujours et arrivant à bout portant sur monsieur de Damas, lui pose le canon de son pistolet à toucher le front. Il s’arrête et lui dit : « Me rendez-vous ma compagnie ? » – « Non… » répond encore monsieur de Damas. – « Une seconde fois, me rendez-vous ma compagnie ?? » – « Non » – « Me rendez-vous ma Compagnie ?? » – « Non » répond encore monsieur de Damas, « tant que je serai quelque chose ici vous n’y serez rien » – « Eh bien – dit monsieur du Chaffaut, je ne tuerai pas un brave homme comme vous » et il jeta au loin son pistolet après avoir tiré en l’air.
Le comte de Damas avait étonné les plus braves par sa folle intrépidité, mais parut trop militaire à ses nouveaux subordonnés ; plusieurs officiers demandèrent à quitter le corps ; le Marquis de Boutillier s’y opposa résolument et monsieur de Damas offrit de « rendre raison de gentilhomme à gentilhomme à quiconque se présenterait ». Les incontestables qualités militaires de monsieur de Damas devaient bientôt lui attirer l’estime et l’affection générale.
Bittard des Portes(histoire de l’Armée de Condé).
Les deux duels qui en ont résulté, heureux pour moi, l’ont été encore plus dans la suite : ils m’ont institué l’arbitre de toute espèce d’innovation ou de procédés quelconques sans me laisser la douleur de regretter d’avoir jamais fait tort à l’avenir d’un gentilhomme expatrié servant sous mes ordres.
(Mémoires du Comte Roger de Damas)

Il offrit un louis d’or au grenadier qui irait la lui chercher. Deux ou trois de ces braves furent se faire rompre les os. Aussitôt, quoique trop tard, Monsieur de Damas défendit qu’on renouvelle cette tentative. Cette bravoure était générale à l’armée de Condé, officiers généraux, officiers supérieurs, subalternes, sous-officiers, et soldate avaient une énergie peu commune, soutenue d’ailleurs par leur dévouement au roi et à la France. Cette petite troupe, toujours mise en avant par les généraux des armées étrangères, avait eu souvent à soutenir le poids écrasant des armées de la République. Il y avait peine de mort pour les émigrés pris les armes à la main ; aussi ne se rendaient-ils jamais et se défendaient-ils à outrance. Plusieurs cependant furent pris et passés par les armes. L’un d’eux fut conduit de poste en poste jusqu’au quartier général de Moreau, qui commandait l’armée française ; il savait parfaitement le sort qui lui était réservé et il attendait avec calme que l’on eut le temps de s’occuper de lui. Son tour arrive enfin. Il est amené devant le Général en chef, qui lui parle en ces termes :
- « Comment vous appelez vous ? »
- « de Covins ! »
- « vous dites ? »
- « de Covins du Valais ! »
- « Très bien et vous êtes émigré ? »
- « Oui, mon Général ! »
- « Vous avez été pris les armes à la main ? »
- « Oui mon Général ! »
- « Vous connaissez le décret qui règle le sort des émigrés pris les armes à la main ? »
- « Parfaitement mon Général ! »
- « Vous me voyez obligé, à mon grand regret, de donner des ordres à votre sujet, vous n’avez pas à réclamer ? »
- « Oh mon Dieu non ! »

Dans ce cas…, et Moreau se tournant vers un de ses aides de camp, lui dit ces mots à l’oreille. L’aide de camp s’incline et le général dit monsieur du Valais : « Suivez monsieur ». L’aide de camp le dirige vers un poste commandé par un officier, lui parle bas et lui remit son prisonnier. L’officier fait monter à cheval un autre officier et quelques cavaliers. On emmène monsieur du Valais parfaitement convaincu qu’il est entre les mains d’un peloton d’exécution. L’on marche toujours. Enfin lorsqu’on est arrivé en rase campagne, l’officier s’adresse à monsieur du Valais et lui dit :
- « Savez-vous parler l’allemand ? »
- « Oui Monsieur ! »
- « Et bien alors allez-vous en là-bas à cette ferme, et informez-vous si nous sommes bien sur la route qui conduit à… »
- « Oui mon officier ! ».
Et là, de Covins se dirige tranquillement vers la ferme d’où il revient, sans se presser, pour donner au chef d’escorte l’assurance qu’il ne s’est pas trompé et qu’il est bien effectivement sur le bon chemin. L’officier le prend par Ies épaules et le pousse en disant :
- « Il faut que vous soyez bien simple pour ne pas comprendre ! »
- « Et quoi donc ? »
- « Eh pardieu qu’on vous donne la clef des champs ! »
S’il est juste de reconnaître avec quelle douceur le général Moreau savait tempérer les rigueurs de la sanglante république , il convient de remarquer, peut-être davantage, le calme, le sang-froid et, par-dessus tout, la naïveté, pour ne pas dire la bêtise, de du Valais de Convins, ne se doutant pas qu’il agissait à la façon de Regulus dont il ignorait probablement le nom.
Cette noble leçon d’humanité peut faire pendant au trait suivant, du duc d’Enghien.
Un jour voyant un officier de dragons se défendre avec le courage du désespoir contre plusieurs soldats du régiment de Baschi, le jeune prince s’approche, fait retirer les assaillants, et demande à ce brave officier pourquoi il s’obstine à une lutte inégale ?
– « J’aime mieux me faire tuer le sabre à la main que d’être fusillé ».
– « Fusillé, reprend le duc d’Enghien, vous seriez le premier ».
Il l’emmène avec lui au quartier général où ses blessures furent pansées, et, pendant plusieurs semaines, le prisonnier devint l’objet des soins et des égards dus au courage malheureux.

Monsieur du Valais, au surplus, jouissait d’une réputation de simplicité aussi bien établie que sa réputation de bravoure. Il était le frère de monsieur le Colonel du Valais, que nous avons tous connu, faisant une active propagande en faveur de Louis XVI et attendant l’incarnation du Saint Esprit. Tous nos contemporains savent qu’il se croyait archange et qu’il se nommait Raphaël.
Monseigneur le duo d’Enghien qui était si bon, si gracieux, si aimable avec ses entours, et particulièrement avec les officiers qui, par leur âge, leurs qualités et leur caractère, avaient su mériter sa bienveillance, ne l’était pas moins avec les dames.
Pendant la retraite de Moreau, mon père se trouvant à l’extrême avant garde avec son frère était arrivé de bonne heure dans une petite ville ; il était chargé de faire les logements et il avait naturellement choisi pour, lui et son frère la maison du Bourgmestre, où ils étaient installés. Libres de leurs mouvements, ils étaient allés au-devant de leurs amis quand ils apprirent que les gens de Monseigneur le duc d’Enghien n’avaient pu trouver un logement convenable pour le prince. Mon père s’empressa d’aller lui offrir la maison qu’il occupait. Le prince ne voulut l’accepter qu’à la condition de partager ce logement avec lui et il se mit en chemin pour s’y rendre. Mais mon père l’avait devancé pour prévenir la femme du bourgmestre que le duo d’Enghien venait occuper sa maison. Cette dame, fort jolie du reste, en fut quelque peu troublée, et ce fut avec un embarras qui la rendait charmante qu’elle voulut exprimer au prince combien elle était flattée de recevoir chez elle le petit neveu du roi de France, et son regret de ne pouvoir pas lui faire un accueil digne de lui.
« C’est bien….. C’est très bien » dit le prince en lui prenant la taille et en l’embrassant sur les deux joues. « Est-ce que vous ne me croyez pas aussi bon enfant que monsieur ? » Et il désignait mon père.

Ce logement fut envahi par les vieux gros bonnets de l’état-major particulier du prince, et mon père et mon oncle durent faire vider et approprier une écurie pour s’y loger.
Pendant cette célèbre retraite de Moreau, l’armée de Condé, et particulièrement la légion de Damas qui faisait son avant garde, était toujours en l’air, dormant à peine , se levant et se mettant en marche plusieurs heures avant, le jour. Officiers et soldats étaient tellement abimés de fatigue qu’ils marchaient en dormant.
Il est à remarquer que c’est aux époques où elle se rendait le plus utile qu’elle était réduite aux plus grands sacrifices, et que c’est toujours, non au poids de l’or mais au poids des boulets qu’elle devait acheter les faible secours que elle obtenait.
(Mémoires du comte Roger de Damas)
Succédant comme aide major à monsieur de Boissezon, mon père s’attachait fortement sur son cheval, et escorté de son fidèle Balberoth (son chien) courait ainsi, pour son service, d’un bout de colonne à l’autre ; poussant les uns en avant et ramassant les trainards. Son chien Balberoth était si bien connu que dès qu’on l’apercevait on pensait bien que son maitre n’était pas loin.
Un jour, chevauchant avec son frère pour activer quelques retardataires, ils reconnurent le cheval de monsieur le major de Th à la porte d’un cabaret. Présumant qu’il pouvait lui être arrivé quelque, chose de fâcheux, ils descendirent de cheval et entrèrent dans le cabaret. Ils entendent du tapage, courent au bruit, et, dans une chambre écartée, trouvent le major attaché à un lit par deux soldats qui étaient en train de l’assommer. Ils commencent par tomber sur ces deux soudards qu’ils accablent de coups de canne ; les font sauter par la fenêtre, et délivrent ce pauvre major qui était entré dans ce cabaret pour relancer quelques trainards qui voulurent profiter de l’occasion pour lui faire payer toutes les misères qu’il leur avait faites. Heureusement pour lui, ses deux camarades arrivèrent à temps pour le tirer des mains de ces drôles. Cette affaire ne fut pas ébruitée pour éviter aux deux soldats une condamnation à mort.

Ce fut en 1797 que l’armée de Condé, qui était payée par l’Angleterre, passa à la solde de la Russie. L’empereur avait eu le projet d’envoyer toute cette noblesse française en Crimée, et voulait donner à chaque émigré une cabane, un lopin de terre, une vache et un veau. Ce projet ne fut pas mis à exécution. Ce qui n’empêchait pas les jeunes émigrés de mettre en jeu les libéralités de l’empereur de Russie. Plus d’un, n’ayant point de quoi faire sa partie, jouait sa vache, son veau et ses propriétés futures en Crimée.
L’armée de Condé eut l’ordre d’aller prendre ses cantonnements vers Uberlingen qui devint le quartier général de monsieur le prince de Condé. La légion cantonna dans les dépendances de Wurzach. Les Anglais n’ayant plus besoin des services de l’armée de Condé, étant prêts eux-mêmes à conclure leur paix particulière, annoncèrent sa réforme dans le courant de l’été.
Il était certain que le cabinet de Vienne ne la reprendrait pas à sa solde elle touchait en conséquence à son licenciement général.
Le prince de Condé, toujours plein de sollicitude pour le sort de ses compagnons d’armes, les engagea à profiter de la bienveillance de l’empereur Paul. Il fut convenu que l’armée passerait de la solde anglaise à la solde russe, et que les comptes et le licenciement seraient faits de la part des Anglais, qu’aussitôt elle se mettrait en marche pour la Volhynie, où elle serait organisée selon les règlements russes.
L’armée de Condé partit pour la Pologne. Elle fut embarquée sur le Danube jusqu’à Linthz et de là elle dut gagner par terre la ville de Lutsko en Wolkynie, et le duc d’Enghien établit son quartier général à Dubno.
On n’était pas arrivé depuis trois jours en Pologne, que Monsieur de Perrin se vantait de parler déjà le polonais. Monseigneur le duc d’Enghien, qui connaissait cette prétention et la considérait comme exagérée,

S’adressa à un grand seigneur polonais et lui demanda s’il était vrai que monsieur de parlât le polonais aussi bien qu’il le prétendait : « Ma foi, monseigneur, répondit-il, il n’y aurait rien d’étonnant à cela, monsieur de Perrin parle dix fois plus qu’un autre, il ne serait pas impossible qu’il sache parler une langue dix fois plus vite qu’un autre ».
Monsieur de Perrin n’avait pas seul des prétentions du même genre. Monsieur le chevalier de Raynaud de Martinet se croyait pour le moins aussi habile. En arrivant en Pologne, il eut une grave maladie et mon père s’empressa d’aller le voir. Il le trouva en bonnet de nuit et robe de chambre au milieu d’un tas de papiers, encore à peu près intacts.
- « Que faites-vous donc là, chevalier, au milieu de toute ces paperasses ? »
- « Ce que je fais. Je vais vous le dire…. Je fais une grammaire polonaise. »
- « Ah… et vous savez le polonais ? »
- « Pas le moins du monde. »
- « Du moins savez-vous comment on demande du pain ? »
- « Pas du tout. »
- « Eh bien, alors »
- « Alors….. Ah çà mais vous croyez peut-être qu’il y a dû mérite à faire une grammaire dans une langue que l’on connait ? Le mérite est de la faire dans celle que l’on ne connait pas ! »
Mon père dut se contenter de cette explication, et garda par devers lui ses convictions sur le mérite du chevalier de Martinet, qui, tout original qu’il était, aimait mon père au point qu’il voulait le faire, et le fit, son héritier pendant cette maladie dont il se releva, et après laquelle il reprit son service. Rentré plus tard en France, où il vécut encore longtemps à l’époque de sa mort, en 1832, je me trouvais compris dans son testament pour la jouissance du tiers de son indemnité d’émigré jusqu’à la parfaite majorité d’un de ses petits neveux, voulant nie donner, disait-il, un avant-gout des biens de ce monde.

Si j’avais le soin de marcher sur les traces de mon père ; naturellement je répudiai ce legs parti d’un grand cœur et d’une tête folle , ne voulant pas d’ailleurs frustrer en rien les intérêts de mon ami Raynaud ou de ses enfants.
L’état-major de monseigneur le duc d’Enghien se composait d’hommes plus âgés que lui, de têtes froides, de gens sérieux que le prince laissait volontiers pour rejoindre ses jeunes amis et s’amuser avec eux. Il était d’une grande habileté à patiner et se réjouissait beaucoup de la maladresse et des chutes des jeunes gens qu’il emmenait avec lui pour prendre part à cet exercice. Il écrivait leurs noms sur la glace, les devançait, tournait autour d’eux ; et franchissait deux cannes qu’il faisait placer sur la glace, à la distance de douze semelles, il évitait toute sorte d’obstacles et s’élançait en avant pour sauvegarder ses amis maladroits.
Cet exercice du patin, très attrayant par lui-même, se renouvelait sans cesse en Pologne. Aussi mon père était-il devenu assez adroit. Malgré cela il devait déployer toute son habileté pour pouvoir suivre le prince qui mettait une grâce infinie à ne pas trop le distancer, et le dédommageait en le plaisantant de ses chutes plus désagréables que dangereuses. Une fois cependant n’ayant pas aperçu un trou pratiqué dans la glace pour prendre du poisson, il y tomba en plein et ne dut son salut qu’à une perche qu’il tenait dans ses mains et qui se trouvant naturellement et heureusement en travers du trou et lui servit de point d’appui pour en sortir.

Pendant cette année 1798, passée en Pologne, la glace se trouvait encore assez forte pour porter même de l’artillerie. Monsieur le baron d’Escorbiac de Vilanges et mon père avaient profité d’une journée tant peu tiède pour monter à cheval, et, sans tenir compte de l’influence que cette température radoucie pouvait avoir sur la glace, s’aventurèrent sur une rivière gelée pour rentrer à leurs cantonnements. Ils n’étaient pas encore loin du bord quand la glace se rompit sous l’un des pieds de derrière du cheval de monsieur d’Escorbiac, qui appuya fortement l’autre pied pour se dégager. La glace se brise et le cheval effrayé, s’élance des pieds de devant sous lesquels la glace éclate et ne résiste que sous le menton de la pauvre bête, Avec ce faible point d’appui l’animal peut encore nager et porter son cavalier. Voir le danger de son camarade et sauter bas de son cheval fut pour mon père l’affaire d’un instant, il empoigne monsieur d’Escorbiac par sa queue (car alors on portait la queue) l’enlève de sa selle et le dépose sur la glace. Les voilà tous deux en devoir de délivrer à son tour le cheval, qui débarrassé du poids de son cavalier se soutenait encore en nageant, toujours appuyé sur la glace. L’instinct de conservation lui donna la patience de se laisser prendre une jambe de devant qui fut placée auprès de son menton ; mais cette délicate opération fut longue et fort dangereuse. Pendant ce temps, le cheval de mon père abandonné à lui-même, avait pris le galop et regagné son écurie : officiers et soldats voyant le cheval revenir les arçons vides, dirent entre eux : « C’est le cheval d’un officier d’infanterie, ces messieurs n’en font jamais d’autres, de Bonne se sera fait désarçonner et il se sera cassé quelque membre, suivons sur la neige la trace du cheval et allons voir ce qui a pu lui arriver », et en effet en suivant la piste, ils arrivèrent au moment où la seconde jambe du cheval venait d’être placée près de la première. Il ne restait plus dans l’eau que l’arrière-train qu’on essaya de soulager en lui passant une courroie sous le ventre. Mais l’animal voulant s’aider lui-même

S’élance de nouveau et vient briser la glace aux pieds de tous ses sauveteurs. Il disparait, sans cependant n’entrainer personne avec lui. À la débâcle qui eut lieu peu de jours après, on le trouva noyé à quelques centaines de pas en aval du théâtre de ce terrible accident. Monsieur d’Escorbiac fit retirer la selle et la bride qu’il a toujours conservées.
Il résulta de cet évènement une liaison encore plus grande entre ces deux messieurs, et elle n’a cessé qu’avec la vie .
Ce fut par monsieur d’Escorbiac de Vilanges que nous fumes recommandés à son neveu l’abbé d’Escorbiac, directeur du collège de Juilly.
Casimir, Henri et moi y avons été toujours parfaitement traités. En mon particulier, je conserve un précieux souvenir du collège de Juilly et de son charmant directeur.
Les émigrés français étaient très bien traités par la noblesse polonaise, je l’ai souvent entendu dire à mon père, qui se rappelait volontiers le bon accueil qu’il avait reçu chez la princesse Lubormiska. On avait polonisé son nom de Bonne, on en avait fait Bonowski. À l’époque où ils étaient aux environs de Cracovie, quelques officiers, familiers du duc d’Enghien, eurent la pensée d’aller visiter cette ville, et durent lui en demander la permission. Le prince, habitait un petit château, sans gardes, sans factionnaires, sans domestiques même, du moins au moment où ces messieurs se dirigeaient vers son appartement, car ils ne trouvèrent personne pour les annoncer.
Toutefois, ne voulant pas commettre d’indiscrétion, ils parlaient haut et faisaient du bruit, si bien que le prince les appela et ils le trouvèrent en tête à tête assez intime avec la princesse Charlotte de R !… qui ne se troubla pas le moins du monde.
- « Eh bien, Messieurs, qu’est-ce qui vous amène et que puis-je faire pour vous ? », dit le prince
- « Monseigneur, nous voilà près de Cracovie et nous venons vous demander une permission pour visiter cette ville. »

- « A…. Voyez-vous (dit le prince en s’adressant à la princesse Charlotte), ils veulent aller voir des demoiselles. »
D’après ce langage sans façon tenu devant la Princesse, ils furent bien convaincus qu’il existait entre elle et le prince des relations de la plus grande intimité.
Pendant leur séjour en Pologne, les officiers de l’armée de Condé allaient souvent au bal chez quelques grands seigneurs par qui ils étaient invités et bien accueillis. L’un des usages qui avait frappé mon père dans ces réunions de l’aristocratie polonaise, était celui de commencer le bal par une Polonaise qui était jouée par l’orchestre.
Le maître de la maison ou le personnage le plus considérable offrait sa main ou son bras à la dame à qui il voulait faire le plus d’honneur, et suivi par toute l’assemblée formée en couples, exécutait une promenade dans les salons de réception.
Il nous racontait aussi comment s’y prenaient les paysans de l’Ukraine pour prendre les chevaux qui vivent en quantité dans ce pays à l’état, sauvage ; les jeunes paysans le plus lestes s’armaient d’une corde à l’extrémité de laquelle était pratiqué un nœud coulant, ils le lançaient à la tête du cheval ; quand le cheval était pris par le cou et cherchait à se dégager par mille secousses, par des courses folles, les jeunes paysans s’attachaient à la corde, qu’ils se passaient successivement avec beaucoup d’adresse ; le cheval les trainait, les emportait, mais il finissait par s’essouffler, se fatiguer et se laisser prendre. Cette chasse au cheval offrait à messieurs les émigrées un spectacle aussi attrayant mais moins gracieux que celui de la danse de la polonaise, qui, du reste, se danse encore aujourd’hui au début de toutes les réunions, en Pologne, et même en Russie, et qui est d’un effet ravissant, d’après ceux qui ont pu y prendre part.

Éloignés de la France, et dans leur triste position, les émigrés avaient quelquefois des retours de gaieté, et les jeunes officiers se permettaient de s’amuser, même aux dépens de leur aumônier, monsieur l’abbé Jaquin, pour qui, ils n’avaient pas une bien vive sympathie.
Étant de garde près du logement du Duc d’Enghien, quelques une de ces messieurs imaginèrent de déguiser l’un d’eux en abbé Jaquin et lui firent jouer le rôle d’un homme qui a trop bu. Il était presque nuit et tout était disposé pour que le prince ne perdit rien de cette scène. Le succès fut complet.
Le lendemain le duc d’Enghien voyant l’aumônier dans son salon, au milieu de ses officiers, se tourne vers lui et lui dit :
- « Mon cher abbé, je ne trouve certainement pas mauvais que l’on s’amuse et même que l’on soit un peu en train, mais vous devez comprendre que, dans votre position et avec votre habit, il ne convient guère de se laisser voir même avec ces Messieurs, après un repas peut-être un peu trop gai, ou du moins un peu arrosé, vous me comprenez n’est-ce pas ? ? », le pauvre abbé n’y comprenait rien, balbutiait, semblait s’excuser. Le prince insistait avec bienveillance, lorsque les rires étouffés de ses officiers, lui firent comprendre que les jeunes gens s’étaient amusés aux dépens de leur aumônier. Ils furent à leur tour l’objet de quelques paroles sévères ; ils durent faire des excuses à l’abbé Jaquin et l’on finit par rire de cette plaisanterie, comme l’on avait ri de celle d’un tout jeune homme ; Monsieur de Turpin.
Monsieur de Turpin était un étourdi de premier ordre qui s’était attiré une sévère admonestation de son colonel monsieur de D…. qui finit par lui dire :
- « Savez-vous, Monsieur, que depuis longtemps vous avez fait dans ma malle. »
- « Ah mon Colonel, s’écria naïvement un jeune cadet, il a fait aussi dans la mienne…. Tableau….. » Rires fous, car tout le monde savait que monsieur de Turpin avait déposé un cas….. réservé dans un coffre de ce jeune naïf débutant au régiment.

Ce fut au mois d’août 1799, que l’armée de Condé quitta la Pologne pour revenir sur les bords du Rhin, et sur les frontières de la Suisse, où se trouvaient les armées alliées sous les ordres du maréchal Korsakoff. Pour regagner la Bavière, elle dut traverser la Bohème, et se trouva réunie à Prague, ou dans les environs. Partout, le passage de cette armé excitait l’admiration et la sympathie des populations, qui ne voyaient pas, sans une émotion bien vive, les rangs de ces troupes, où l’on comptait des commandeurs et des chevaliers de Saint-Louis, de Saint-Lazare et de Malte, des vieillards portant le sac sur le dos et le fusil sur l’épaule, avec autant d’aisance que des jeunes gens.
Le général autrichien, qui voyait défiler cette noble troupe, ne peut maitriser son émotion, et, s’adressant à ses officiers, leur dit :
« Eh bien, Messieurs, en pareille circonstance, en eussiez-vous fait autant ? » Des gestes d’admiration furent leur seule réponse. Un spectacle aussi extraordinaire (Marquis d’Ecquevilly) avait tellement excité la curiosité générale que des gradins avaient été élevés sur la place de Prague, pour y placer des femmes, qui, par leurs acclamations et leur attendrissement, témoignais l’admiration qu’excitait en elles un si héroïque dévouement.
À la nouvelle des désastres que l’armée Russe, sous les ordres de Korsakoff, avait éprouvés devant Zurich, le prince de Condé jugea que les circonstances exigeaient qu’il accélérât sa marche ; et le 1er octobre I799, l’armée de Condé se retrouva sur les bords du lac de Constance, qu’elle avait quitté deux ans auparavant, ne s’attendant pas à les revoir aussitôt. Le 7, le prince de Condé fit faire une reconnaissance qui n’empêcha pas les Français de s’emparer de Constance et de s’y enfermer, avant que les troupes chargées de se porter en avant, puissent y rentrer. Les grenadiers de Bourbon, dont mon père faisait partie, trouvèrent les portes de la ville fermées ; ils les enfoncèrent, se firent jour à la baïonnette, culbutant tout ce qui se trouvait devant eux, tirant et recevant des coups de fusil qui leur firent perdre beaucoup de monde.

Dans cette sanglante retraite, les grenadiers de Bourbon, conduits par le major de Th…. s’étaient engagés dans une rue qui, au lieu de les conduire au pont qui n’était pas encore coupé, les menait droit au lac. Le major de Th… se met à l’eau avec son cheval, mais le reste de sa colonne ne voulant pas prendre un bain forcé, fait volteface, revient sur ses pas, refoule les ennemis qui la serraient de près, les culbute et les fait reculer jusqu’à la rue qui devait les conduire au pont, et par ce fait reprend sa véritable direction, servant maintenant d’arrière-garde au petit corps d’armée dont elle avait été tête de colonne en rentrant à Constance. Elle passe le pont, que le duc d’Enghien fait détruire, et retrouve le major de Th… sur l’autre rive, tout mouillé, ruisselant d’eau et couvert de vase depuis ses bottes jusqu’à son chapeau, assez penaud de s’être jeté à l’eau tandis que ceux qu’il commandait s’étaient jetés au feu
Cette affaire de Constance couta beaucoup de monde à l’armée de Condé, mais les succès de l’armée républicaine n’en continuèrent pas moins. Le général Korsakoff remporta un avantage mais sans conséquence et sans résultat pour les combinaisons du maréchal prince de Souvarov qui du pays des grisons remonta vers Constance pour songer faire prendre les quartiers d’hiver à son armée.
Le grand-duc Constantin, second fils de l’empereur de Russie, avait fait la campagne avec Souvarov. Il voulut voir les régiments du prince de Condé. Ce dernier retarda son départ pour Memmingen afin d’assister au passage des grenadiers de Bourbon, que le grand-duc lui avait témoigné le désir de voir.
C’est ce grand-duc Constantin qui plus tard, fut le protecteur de monsieur de Boissezon père de Constantin.

Mon père nous racontait qu’il avait connu le général marquis de Boissezon, qui mourut à l’armée de Condé, laissant une fille et un fils qu’il recommanda à son lit de mort à monseigneur le duc de Bourbon. À son tour le duc de Bourbon recommanda ces deux enfants à l’empereur de Russie qui fit placer la demoiselle à la pension des demoiselles nobles à Saint-Pétersbourg, elle est actuellement dame d’Honneur de la reine de Bavière.
Le jeune homme eut placé l’école des cadets, aussi à Saint-Pétersbourg, mais il fut obligé d’en sortir pour avoir contrevenu aux règlements de cette institution, en obligeant un français, un compatriote ; cela ne l’empêcha pas d’être apprécié et protégé par le grand-duc Constantin et de devenir major général au service de la Russie. C’était un monsieur charmant, aussi modeste que brave ; quelques personnes se souviennent de l’avoir vu à Castres, en 1815, et ont conservé de lui un excellent souvenir. On se rappelle qu’il ne voulut pas paraître avec l’uniforme de son grade pour éviter de froisser l’amour propre des Français, quelque peu humiliés de voir la France envahie par les troupes étrangères. Il était père de Constantin de Boissezon, mort en 1872, et qui reste célèbre dans le pays par son caractère bizarre et par son originalité. Sa femme (mademoiselle de Pins) et ses enfants continuent les nobles traditions de leurs familles.
Après les affaires de Constance, l’armée de Condé resta quelque temps encore à la soldé Russe, elle fut envoyée à Lintz et peu après passa, pour la seconde fois, à la solde anglaise. Nous avons vu à Hauterive, chez monsieur de Villeneuve, le ministre anglais, Monsieur Wicam, à qui, dans cette circonstance, eut affaire monseigneur le prince de Condé.
Les Anglais voulaient faciliter aux royalistes français un mouvement dans le Midi de la France.

Ils firent passer l’armée de Condé en Italie pour l’embarquer et la jeter sur les côtes du Languedoc, mais ce projet n’eut pas de suite et l’armée ne fit que passer dans le Nord de l’Italie. Elle fit cependant un court séjour à Venise où se trouvait alors le Pape, qui donna d’abord une audience particulière à monseigneur le prince de Condé et au duc d’Enghien, et admit ensuite tous les officiers en audience publique. Mon père attachait un grand prix au souvenir de la visite au saint Père et aux termes bienveillants avec lesquels il avait accueilli les princes de Condé et les officiers de leur suite.
Le retour de l’armée de Condé en Bavière, la diminution de son effectif, le découragement des ans, la désertion qui commençait à gagner parmi les simples soldats faisaient pressentir la dissolution d’un corps à qui l’Angleterre semblait vouloir donner une destination inadmissible pour le prince de Condé et pour ceux qui avaient l’honneur de servir sous ses ordres. Le licenciement de l’armée de Condé eut lieu à Feistritz, en février 1801 (en Styrie entre Graats et Laybach).
Retour au pays
Mon père et mon oncle avaient servi dans ses rangs depuis la formation en I792 jusqu’à son licenciement en 1801. C’est de Graats qu’ils partirent pour rentrer en France après neuf ans de la vie pénible des émigrés faisant la guerre contre la sanglante république, et ayant dû supporter, avec une constance héroïque, toutes les misères qu’elle engendrait, alors surtout qu’il ne pouvait exister de relations avec leurs familles.
Les deux frères partirent donc pour rentrer en France et dans leurs foyers, qu’ils devaient trouver déserts et glacés. Ce fut par Lyon que s’opéra leur retour, et sur un petit bateau plat, qu’ils durent descendre le Rhône pour regagner le Midi de la France, le Rouergue, et Saint-Martin. Dans une voiture publique an voyageur dit en s’adressant à mon père : « Monsieur, vous me faites l’effet d’un émigré ! » – « et vous d’un prêtre ! » c’était vrai ; il faut en conclure que la police française était aveugle ou voulait bien fermer les yeux.

À son arrivée à Saint-Martin, mon père fut reconnu (malgré le changement que neuf années avaient pu apporter à sa personne) par un paysan qui vit de loin un cavalier ramassant la cravache qu’il avait laissée tomber, sans descendre de cheval : « Ce doit être Monsieur Justin, dit-il, car il n’y a que lui qui puisse accomplir un pareil tour de souplesse. » Le retour et l’arrivée à Saint-Martin fut bien triste. La maison vide et déserte, les parents morts, le mobilier détruit ou pillé.
Il fallut pour s’éclairer, le soir, tailler un chandelier dans une rave découpée, pour y placer une chandelle. À part ce dénuement, il y avait bien d’autres misères à redouter. Car s’il était encore possible de ne pas mourir de faim, il fallait être très prudent et très circonspect pour ne pas éveiller les susceptibilités de la police, quelquefois fort brute encore.
Les premières années de leur rentrée en France furent dures à passer pour mon oncle et pour mon père ; retirés à Saint-Martin, ils vivaient modestement, allaient à la chasse où ils étaient quelquefois heureux. Ils firent servir deux lièvres à des curés qu’ils avaient engagés à diner, ceux- ci se récrièrent de ce luxe de gibier : « Si vous dites encore un mot, leur fut-il répondu par mon père, je vous en fais servir un troisième » et effectivement, il y en avait encore un dans une vieille barrique. La confiance commençait à renaître et ces Messieurs se hasardèrent à sortir de Saint-Martin . Ils furent à Toulouse voire leur tante, madame de Graves, qui, bien persuadée qu’ils n’avaient rien mangé depuis leur départ pour l’émigration, leur faisait servir d’énormes repas et profitait du moment où ils tournaient la tête pour remplir amplement leurs assiettes. Ils étaient souvent obligés de protester contre cette abondance et ce bon accueil. Mon père n’avait pu oublier le chemin de Castres où il avait des parents et où s’était retiré ma tante, la religieuse ; il retrouvait d’ailleurs là des camarades d’émigration, monsieur de Goudon, monsieur le chevalier de Lacger, les messieurs de Perrin, etc.,.


et il s’était lié avec des jeunes gens de son âge qui, sans avoir émigré, avaient cependant donné des preuves de leur royalisme et exposé, leur vie pour soutenir le principe monarchique : Les messieurs de Gaix, Messieurs Azaïs, de Milhau, Bousquet et bien d’autres. Généralement la police laissait ces messieurs assez tranquilles, mais ils faisaient quelquefois du bruit, et l’on était forcé de s’occuper d’eux. Dans un bal donné à Frescati, où sont aujourd’hui les Carmélites, Monsieur Bousquet ayant eu un démêlé avec un monsieur Malbouche, lui appliqua un soufflet des plus retentissants. On s’arma de chaises et l’on allait s’assommer, quand on fut prévenu de l’arrivée de la force et il fallut se sauver.
Quelques temps après, mon père reçut un avis d’avoir à se présenter devant l’autorité et se rendit à cette invitation. On lui demandait qui il était ? D’où il venait ? Enfin on voulait l’arrêter quand un jeune homme, un incroyable, se présenta et dit au curieux magistrat : « Monsieur est mon ami et mon parent ; il est marchand de bœufs, il vient de Milhau, je réponds de lui. »
Le magistrat cessa son interrogatoire et renonça à faire arrêter mon père .
Monsieur Villa avait été homme du monde avant d’être prêtre ; son esprit si fin, si délicat, ne lui a jamais fait défaut. Son excellent cœur, son dévouement à tout ce qui était bon et beau, son sens droit, son jugement et ses manières distinguées, l’ont toujours fait remarquer ; et souvent, sous son humble costume de prêtre, il a été pris pour un haut dignitaire de l’Église. Ce digne et vénérable ami se plaisait surtout au milieu des gens du monde bien élevés et distingués comme lui. Ce qui ne l’empêchait pas d’être avec ses confrères du clergé d’une extrême bienveillance. Tous sentaient sa supériorité, il en était peu qui fussent jaloux.
Il portait aux jeunes prêtres et aux abbés qu’il dirigeait vers le séminaire, un intérêt tout paternel. Mais c’est surtout aux familles et aux enfants des anciens amis qu’il s’intéressait de la façon la plus vive. Rempli d’indulgence pour eux, il souriait à leurs folies qu’il ne blâmait qu’en homme d’esprit et d’expérience. Jusqu’aux deux dernières années de sa vie, Monsieur Villa n’a pas manqué de visiter tous les ans ses amis ou les enfants de ses amis. Il nous donnait chaque année une quinzaine de jours, et quand il arrivait à Lostange il était fêté par mon père, par ma mère et par tous leurs enfants. Pendant son séjour parmi nous, il n’était pas possible de s’ennuyer. Il avait toujours mille histoires à nous raconter. Il savait écouter nos plaisanteries, et avec mon frère Casimir, c’était un feu roulant de traits spirituels et piquants. Dormant peu, il récitait ses prières pendent la nuit et il avait la journée libre pour causer, lire, et nous écouter.
Je me souviens d’une de ses visites où il se rencontra à Lostange avec madame de Saint-Maurice (mademoiselle Pauline de Laura) qui était fort spirituelle et fort aimable. Elle disait à Amélie : – « Ma chère ton curé est charmant, mais quand donc dit-il son office ? »
Il le disait de très bonne heure et il avait du temps à lui. Aussi faisait-il à ces dames la lecture de quelques vaudevilles un peu légers et il s’arrêtait aux endroits les plus périlleux, en leur disant : « Je m’arrêterai, mesdames, si vous le voulez.., voyez… décidez… » et il continuait sa lecture faisant ressortir de la manière la plus spirituelle et la plus fine tout ce que le vaudeville avait de plus piquant.
L’amabilité de Monsieur l’abbé Villa, sa bienveillante indulgence et le vif intérêt qu’il nous témoignait si chaudement, auraient suffi pour lui assurer un accueil toujours empressé de notre part, si nous avions pu oublier à quels dangers il s’était exposé pour éviter à notre père une arrestation, dont les conséquences eussent pu être graves et peut-être funestes.
De pareilles preuves de dévouement sont précieuses à conserver dans les familles et le souvenir doit en être transmis à ceux qui doivent nous succéder.
Je ne veux pas oublier de consigner ici un service du même genre qui fut rendu à mon père par monsieur Séverac, commissaire de police. Monsieur Séverac avait reçu l’ordre d’arrêter ou de faire arrêter mon père, qui était alors à Castres où il ne prenait pas la peine de se cacher. Monsieur Séverac fut le prévenir et lui fit part des instructions qu’il avait reçues.

Mon père, après l’avoir remercié, s’empressa de décamper. Il dut passer la rivière de Castres au-dessous du cimetière de Saint-Roch. Les eaux étaient basses, et il n’eut qu’à quitter ses bottes et put traverser l’Agout sans trop se mouiller. Il évita ainsi le centre de la ville et les ponts où il aurait pu être remarqué il fila vers La Salvetat, où il put demeurer quelque temps sans être inquiété.
Plus tard, en 1814, il fut assez heureux pour pouvoir rendre à Séverac un service à peu près semblable. Il était avec une société nombreuse, dans le salon de Mme de Lastours, et, par un plus grand des hasards, il entendit de Cazes, préfet du département, donnant l’ordre d’arrêter monsieur Séverac. Mon père s’esquiva sans qu’on y prît garde, courut après Séverac, le rencontra, le prévint des ordres donnés par monsieur de Cazes, et rentra bientôt après dans le salon de madame de Lastours. Dans le courant de la soirée, l’agent de monsieur le préfet se présenta de nouveau. Et lui apprit que Séverac avait sans doute été averti et qu’il s’était sauvé. Monsieur de Cazes et son agent se creusaient la tête et cherchaient inutilement par qui monsieur Séverac avait pu être prévenu. Ils en parlaient à haute voix sans se gêner et mon père se mêlant à leur conversation : « Vous verrez, leur dit-il que ce sera par le grand turc ! » – « Le grand turc c’est vous ! » lui dit monsieur de Cazes qui ne fut pas fâché de n’avoir pas à faire faire cette arrestation.
Cependant, toutes les tracasseries et les misères que l’on faisait endurer aux émigrés, avaient cessé envers mon oncle et mon père. Une influence assez puissante avait officieusement mis un terme à cet état de choses. Ils ont ignoré longtemps, l’un et l’autre, à qui ils devaient ce temps de calme et de tranquillité. Ce ne fut que quelques années plus tard que mon père et mon oncle surent que leur protecteur était le vicomte de Bonald, leur parent, qui les avait fait radier de la liste des émigrés par le consul Lebrun, depuis duc de Plaisance, avec qui il était lié par un commerce de lettres.

Comme ils demandaient à monsieur de Bonald comment il leur avait laissé ignorer que c’était à lui qu’ils devaient la radiation, se dérobant ainsi à leur reconnaissance. Il leur répondit qu’il s’était déterminé à ne point se faire connaître parce qu’ayant eux aussi des amis, ils auraient peut-être voulu l’intéresser à eux et que cela ne lui étant pas possible. Il aurait eu le regret de leur refuser. Mon père, tout en l’assurant de sa reconnaissance, lui ayant demandé d’où venait qu’il portait tant d’intérêt à la famille de Bonne : « C’est, lui répondit le Vicomte, que dans des temps ou ma famille a été malheureuse, les vôtres ne nous ont pas abandonnés, au contraire, ils nous ont rendu service et nous sommes vos obligés ! »
Monsieur le vicomte de Bonald n’a pas borné là les marques de l’intérêt qu’il a toujours porté à notre famille. Il a puissamment contribué en 1827 à faire nommer mon père à la sous-préfecture de Saint-Pons, et il continua avec lui jusqu’à sa mort une très affectueuse correspondance.
À la fin de l’année scolaire I829, ce fut monsieur le vicomte de Bonald, pair de France, qui vint présider la distribution des prix du collège de Juilly. Il avait été désigné à cet effet par le roi, pour représenter le duc de Bordeaux qu’il devait accompagner.
Auparavant, il nous fit appeler dans son appartement, nous gracieusa beaucoup, questionna longuement Casimir sur la carrière qu’il voulait embrasser, et le recommanda à ses examinateurs, en sorte que mon frère fut admis à l’école de Marine dans un bon rang.
Le Général de Bourmont, ministre de la Guerre, assistait à cette distribution de prix. Mais monsieur de Bonald fut seul prendre la parole. En effet il sortit de sa poche un petit carré de papier, s’inclina, et débuta par ces mots : « Monseigneur… ». Il croyait s’adresser au duc de Bordeaux, puis il s’aperçut de sa distraction et dit un mot à l’oreille de monsieur le Bourmont capitaine d’Etat-major et fils du ministre de la Guerre.
Le jeune officier s’élance et court chercher un autre petit carré de papier, que Monsieur de Bonald avait oublié dans sa chambre, croyant laisser le discours, adressé au duc de Bordeaux, devenu inutile par son absence, tandis qu’il avait pris sur lui celui qui ne devait pas être lu.
On sourit, la musique du collège joua un morceau, et au retour de monsieur de Bourmont, monsieur de Bonald nous débita son discours. On ne songea plus à sa distraction quand on eut entendu les aimables et charmantes choses que Monsieur le vicomte de Bonald avait à nous dire.
Nos relations avec ses fils et petits-fils ont toujours été excellentes.
La radiation officieuse obtenue par monsieur de Bonald ne devait pas suffire et mon père dut faire une demande au préfet de l’Aveyron, monsieur de Sainthorent pour pouvoir profiter de l’amnistie accordée par le Sénatus-Consulte de Floréal an 10, laquelle aussitôt fut accordée par le Grand Juge Regner et enregistrée à la Préfecture de l’Aveyron par Grégoire chef de division et par Rudelle Maire.

En 1804, mon père arrivait à l’âge de 31 ans, s’était fait, dans le pays Castrais, une charmante position par son caractère aimable et chevaleresque, il était d’ailleurs fort bel homme, fort distingué de manières et d’une rare intelligence. Ses nombreux et dévoués amis songèrent à le marier. Il ne déplut pas à mademoiselle de Saint-Martial de Lavallongue, et il l’épousa en 1804. Elle était fille de monsieur de Saint-Martial , ancien capitaine aux dragons de la Reine et de mademoiselle de Lavallongue, sa cousine. Ce mariage entre cousine germains était peut-être cause de la gêne que mademoiselle de Saint-Martin éprouvait à marcher, à part cela elle était bien de sa personne et d’une amabilité et d’une douceur de caractère dont j’ai bien souvent entendu faire l’éloge par ma mère, elle eut Justine un peu plus d’un an après son mariage, et j’ai toujours entendu dire qu’elle prit mal en lui donnant à téter, exposée à un courant d’air. C’est à la suite de cette maladie que, mon père devint veuf.
J’ai bien souvent entendu parler de monsieur de Saint-Martial, par ma mère, par monsieur de Passeplanne et par notre vieux et charmant voisin et ami monsieur de Villen ainsi que par les messieurs Guiraud et par les personnes âgées que j’ai connues dans mon enfance. Il est évident, d’après toutes ces personnes, que monsieur de Saint-Martial était le vrai type de l’officier de dragons du dernier siècle.

Il ne restait à Justine du côté de sa mère que madame de Saint-Martial (née Robert) sa bisaïeule, avec qui mon père vécut toujours dans les meilleure termes, elle était originale mais très spirituelle, son affection pour mon père était très grande et elle lui en donnait une grande preuve en lui tolérant chez elle monsieur Rouch, vieux révolutionnaire, qui venait jouer aux échecs avec mon père. Quand il était présent elle se contenait, mais une fois parti elle disait à mon père en patois : « Ah çé néro pas à caouao dé bous, coussi bous estiflario ! » Madame de Saint-Martial avait eu de son fils massacré au 10 Août et son horreur pour les révolutionnaires était très naturelle. Pendant quarante ans de sa vie elle avait, tous les soirs, soupé et veillé chez les Saint-Martin ses parents et amis. En outre des avantages que sa petite-fille avait fait à mon père, elle voulait de son côté lui en faire de très considérables dans son testament, mais mon père ne voulut pas consentir à les accepter. Madame de Saint-Martial avait parfaitement compris que mon père, devenu veuf de sa petite-fille, ne pouvait pas vivre isolé et des personnes de son temps m’ont affirmé qu’elle pensait bien qu’il finirait par se remarier et épouser mère ou une de ses sœurs pour laquelle elle avait remarqué qu’il avait du gout. Elle disait hautement que cela ne lui déplairait pas parce qu’elle connaissait les dames Pigot et qu’elle était bien assurée que sa petite-fille serait parfaitement soignée et traitée. Les évènements ont prouvé qu’elle ne se trompait pas et ses prévisions se sont amplement réalisées, car Justine a été l’objet des soins les plus tendres et les plus affectueux de la part de ma mère et de ma grand-mère.
Après la mort de madame de Saint-Martial, l’isolement de mon père fut complet, et ce fut monsieur de Passeplanne, son cousin, qui le détermina à se marier une seconde fois. Ce fut lui qui négocia et amena la conclusion du mariage de mon père avec ma mère.

Monsieur de Passeplanne aimait beaucoup mon père qu’il avait connu en émigration et dont il avait pu apprécier les éminentes qualités ; il l’appelait « le chevalier sans peur et sans reproche », il lui servit de témoin. Du côté de ma mère ce fut, à part les Figuères, ses cousins, monsieur Roques ami intime de mon grand ‘père monsieur Pigot.
Monsieur Roques avait été député au États généraux, et je conserve de lui une lettre qu’il écrivait à mon grand ‘père, alors que l’on commençait à tourmenter ce pauvre roi Louis XVI. Il est piquant de comparer tout ce qu’elle contient avec ce qui se passe de nos jours. Monsieur Roque était l’ami et le conseil de ma mère et de ma grand’mère. Elles avaient placé ou plutôt prêté une somme assez considérable à une maison de commerce de Marseille qui fit faillite. La somme fut perdue. Monsieur Roques sachant que ces dames avaient fait rentrer quelques créances assez fortes, venait leur conseiller de les bien cacher mais de ne pas les laisser tomber aux moins dans la plavède (c’est le conduit situé entre notre maison à Saint-Pons et la maison de Bon). Monsieur Roques était devenu fort avare et fort sourd, c’était un type assez remarquable.
À partir de 1811, époque du mariage de mon père, il vint s’installer chez ma mère avec sa fille Justine et ses servantes, Jeanneton et Marthe. Cette dernière avait fini par être insupportable pour ma mère et mon père dut la renvoyer. Jeanneton, un peu bête mais assez bonne fille, n’a jamais quitté Justine jusqu’après son mariage. Jusqu’à cette époque, mon père avait toujours habité la maison de Justine à Castres, où à Saint-Pons et il passait l’été au Causse. En 1811, il acheta Lostange et depuis lors il y a toujours passé l’époque de la belle saison. Il paya cette propriété 68 000 francs et y ajouta plus tard pour 30 000 francs environ de nouvelles acquisitions. Au total 98 000 francs.

En 1844, je m’en suis chargé au prix de 180 000 francs, à présent je sais qu’on l’estime près de 300 000 francs. Elle rapporte il est vrai un peu plus qu’à l’époque où mon père en fit l’acquisition, mais cette augmentation de revenus n’est pas en rapport avec la valeur capitale.
La maison de Justine à Saint-Pons, n’était ni habitée ni louée. Mon père put en disposer pour y loger le Cardinal Salutto, à l’époque, ou en 1814, les prussiens et les armées alliées se rapprochèrent de Fontainebleau.
Le Pape et les Cardinaux y étaient détenus par l’empereur Napoléon 1er, envoyés dans le Midi de la France, les Cardinaux furent dispersés dans plusieurs villes. Le Cardinal Salutto, napolitain, fut exilé à Saint-Pons, où mon père le logea et lui procura tous les agréments possibles, dans une si petite ville. Le Cardinal son aumônier et ses gens logèrent dans la maison de Justine.
Mon père, après avoir fourni au Cardinal tout ce dont il pouvait avoir besoin, en mobilier, fruits, vins, vivres de toutes sortes, fut, avec plusieurs autres messieurs de Saint-Pons, l’accompagner Saint-Chinian où ils lui donnèrent un grand, beau et bon diner qu’ils avaient fait préparer à l’avance, de plus, mon père prêta cinquante louis au Cardinal pour l’aider à se rendre à Rome. Le Cardinal Salutto fut parfaitement traité à Saint-Pons par tout le monde, il regorgeait de provision de toutes espèces, il ne lui en couta pas un centime pendant les quatre mois qu’il y passa.
À son départ monsieur Roque, monsieur de Barre et mon père lui fournirent la somme nécessaire pour se rendre à Rome (bien entendu sans intérêts). On aurait pu espérer que le Cardinal, à part les sommes qui lui avaient été prêtées et qu’il a parfaitement remboursées, on aurait pu espérer dis-je, qu’il aurait envoyé un souvenir soit à Justine chez qui il avait été logé gratuitement, soit à ma mère par qui il avait été meublé.
Il n’y a pas songé et il a sans doute oublié fort vite tous ceux qui comme mon père et toute sa famille avaient tenu à honneur de mettre leurs personnes, leurs ressources et leur bourse à la disposition d’un prince de l’Église.


J’avais deux ans à cette époque, mais je me souviens, comme d’un songe, qu’il était toujours question du Cardinal, de ce qu’il avait dit, de ce qu’il avait fait, du lit qu’il avait occupé, qui est aujourd’hui à Mathilde, du buffet sur lequel il avait organisé un autel pour dire la messe et qui est aujourd’hui à la salle à manger de Lostange. On ne me parlait dans mon enfance que de la manière gracieuse dont on traitait le Cardinal quand il revenait de la paroisse et qu’il s’arrêtait à la maison pour s’y reposer avant de rentrer chez lui à la maison de Justine, près du pont de Notre-Dame. On nous racontait qu’à son départ tous les !messieurs de la ville avaient été à cheval jusqu’à Saint-Chinian pour lui faire escorte et qu’avant de les quitter il examinait, beaucoup Monsieur de Barre, Monsieur Roque et mon père et qu’il leur avait demandé de leur expliquer comment eux seuls ne portaient pas des éperons comme tous les autres. La réponse fut des plus simples : ces messieurs devaient, l’accompagner en voiture. Il fut étonné de n’avoir pas pensé à cela. Il n’en a pas moins oublié fort vite ses amis de Saint-Pons.
À l’époque où le Cardinal Salutto était à Saint-Pons, il y avait des prêtres jurés et même un évêque : Monsieur Rouanet qui, à part son serment à la révolution, était un saint homme. Le Cardinal avait été prévenu mais ne le connaissait pas personnellement. Cependant il le devina car Monseigneur Rouanet s’étant présenté chez lui et jusque dans son appartement, le Cardinal se redressa et d’un geste lui indiqua la porte ; cette visite dut être fort pénible pour l’un comme pour l’autre, on ne comprend pas comment l’évêque Rouanet put penser qu’il serait accueilli par le Cardinal. Et le Cardinal dut être bien ému d’avoir à congédier personnellement un personnage dans la situation de monsieur Rouanet.
Je me souviens de l’enterrement de monsieur Rouanet qui fut porté devant la porte de l’Église. La porte resta impitoyablement fermée et le cortège prit immédiatement le chemin de la Bastide où il fut inhumé. Il y avait aussi à Saint-Pons un autre prêtre juré (l’abbé Basquet) qui fit sa rétractation et mourut en paix avec l’Église.